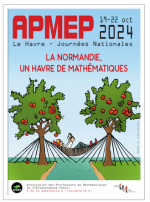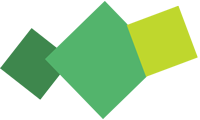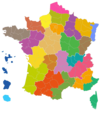488
La dyscalculie développementale : réalité et utilité pour l’enseignement ?
Jean-Paul Fischer [1]
Résumé. La dyscalculie est une notion mal définie dans la littérature. Le renoncement au terme lui-même, dans certaines classifications internationales, ne résout le problème que superficiellement. En effet, remplacer « dyscalculie » par « troubles du calcul » ne répond pas à la question principale : s’agit-il d’un trouble spécifique, c’est-à-dire existe-t-il des élèves qui n’ont des difficultés majeures qu’avec le seul calcul ?
La réponse à cette question conditionne en grande partie l’utilité principale de la notion de dyscalculie, à savoir la mise en oeuvre d’aides spécifiques pour les élèves en souffrant.
La dyscalculie développementale se traduit par une incapacité à apprendre à calculer à un niveau « normal ». Elle doit donc être distinguée de la dyscalculie acquise (ou acalculie) qui peut résulter d’un accident neurologique et qui conduit à la perte des capacités de calcul antérieurement acquises. Du fait que, dès sa définition originelle par le médecin tchécoslovaque Kosc (1974), la dyscalculie
développementale a été reliée à un dysfonctionnement cérébral, possiblement d’origine génétique, elle n’a que très peu intéressé les enseignants de mathématiques : pour la plupart d’entre eux, la dyscalculie relève du domaine médical et non de la didactique. J’ai souligné les dérives gênantes d’une telle position (Fischer, 2009c).
Les possibilités nouvelles, améliorées ou facilitées, d’investigation neurologique ou psychologique, doivent inciter, aujourd’hui, à visiter (ou revisiter) la notion. En particulier, à regarder si ces possibilités nouvelles permettent de distinguer un enfant qui serait dyscalculique, d’un autre qui serait simplement très faible en calcul [2]. Pour cela, je discute brièvement et non exhaustivement les approches neurologiques (partie 2), par la mesure des Temps de Réponse (partie 3) et par la génétique (partie 4), de la dyscalculie. Au préalable, dans la partie 1, je souligne les limites des méthodes classiques : l’observation des erreurs et la méthode statistique. Enfin, dans la dernière partie, je m’interroge sur l’intérêt pédagogique de la notion de dyscalculie.
1) L’insuffisance des méthodes classiques
En premier, on peut se demander si la dyscalculie ne peut pas être caractérisée par les erreurs typiques que feraient les sujets dyscalculiques. La réponse est plutôt négative car les élèves présumés dyscalculiques font généralement les mêmes erreurs que tous les élèves. Simplement ils les font plus fréquemment ou à des âges plus avancés. S’ils font plus d’erreurs exclusivement dans un sous-domaine précis, cela soulève la question de la pertinence d’un syndrome unitaire. Cela soulève aussi la possibilité d’une origine secondaire à un trouble plus général. Par exemple, la
dyscalculie spatiale qui conduit à l’incapacité à aligner correctement les chiffres dans une opération posée peut résulter d’une dyspraxie ; la dyscalculie qui conduit à lire 31 au lieu de 13 peut résulter d’une dyslexie ; ou encore, la dyscalculie des faits (e.g., ne pas savoir que « sept fois sept, c’est quarante-neuf ») peut résulter d’un problème de mémoire déclarative.
Ensuite on peut se demander si l’étude de la distribution des scores à une épreuve de calcul (par exemple l’ensemble des items de calcul des évaluations nationales, maintenant en CE1 et CM2) ne conduit pas à une distribution bimodale : un mode principal, autour duquel se regroupe la grande majorité des élèves et un mode secondaire, autour duquel se regroupe une minorité d’élèves dyscalculiques. Aucune observation, à ce jour et à ma connaissance, n’a mis en évidence une telle distribution bimodale.
Pour identifier statistiquement une dyscalculie, on en est donc souvent réduit à tester si un élève a des performances significativement inférieures à la norme de son âge en calcul, alors qu’il a des performances intellectuelles dans les normes de son âge, ou en tout cas significativement meilleures qu’en calcul, dans les autres domaines. Cette approche conduit à quantité de problèmes pratiques non résolus, voire irrésolubles : construire un bon test de calcul (s’il est court, il sera incomplet ; s’il
est complet, il sera impraticable), tester les autres domaines intellectuels (ce qui oblige à faire des choix ou, en tout cas, à introduire des pondérations), être sûr que les performances des élèves soient reproductibles (sinon un élève pourra être dyscalculique un jour, mais pas le lendemain), etc. Une telle méthode conduit, au mieux, à ce que j’ai appelé des dyscalculies « potentielles », c’est-à-dire des élèves qui, à un moment donné, ont eu des performances faibles en calcul, mais significativement meilleures dans un autre domaine. C’est avec une telle méthode que j’ai pu établir qu’un peu plus de 1% des élèves de CE2 comme de CM2 seraient « potentiellement » dyscalculiques (Fischer, 2007). Ces analyses, sur une dizaine de milliers d’élèves, m’ont aussi conduit à constater que les sujets détectés dyscalculiques se situent le plus souvent à proximité des coupures retenues pour les critères. Les cas convaincants de sujets dyscalculiques, c’est-à-dire des élèves qui seraient brillants en français et nuls en calcul, sont donc extrêmement rares, voire inexistants.
2) Les neurosciences contemporaines nous aident-elles ?
On a identifié, aujourd’hui et grâce aux travaux pionniers de Dehaene et coll., des structures nerveuses précises impliquées dans les traitements numériques, notamment le sulcus intrapariétal (IPS : IntraParietal Sulcus). On peut donc penser que l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), ou d’autres techniques, permettront d’affiner le diagnostic individuel. Certains chercheurs suggèrent d’ailleurs que la moindre activation de l’IPS, visualisée par l’IRM fonctionnelle, serait une preuve de son dysfonctionnement. De telles investigations, outre leur coût, ne peuvent cependant être que complémentaires à des diagnostics davantage comportementaux car une anormalité ou une différence d’activation ne peuvent pas s’interpréter sans plus comme une déficience. En outre, la fonction d’une structure, même très précise comme l’IPS (ou, encore plus précisément, le segment horizontal de l’IPS), est certainement loin de se limiter aux traitements numériques. En conséquence, les chances de détecter ou de confirmer une dyscalculie pure sont réduites : en cas de dysfonctionnement ou de lésion, les sujets auraient des difficultés dans d’autres domaines aussi.
Une première observation expérimentale vient d’ailleurs renforcer le point de vue que l’observation d’une moindre activation de l’IPS est plus qu’insuffisante pour détecter une dyscalculie. Kaufmann et al. (2009) ont en effet observé le contraire : les enfants dyscalculiques produisent des activations significativement plus fortes, notamment dans et autour de l’IPS gauche (lorsque l’activation numérique est comparée au repos) et dans un réseau fronto-pariétal, incluant l’IPS, bilatéralement (lorsque les régions où l’activation par la tâche numérique est supérieure à celle par la tâche spatiale sont considérées).
Plus généralement, observons que les recherches expérimentales classiques (en neuropsychologie), qui consistent à regrouper des sujets présentant un certain trouble et à les comparer à un groupe témoin dans le but de caractériser le trouble, relèvent presque du cercle vicieux. En effet, la constitution d’un groupe de sujets purement dyscalculiques en est un préalable : pour caractériser la dyscalculie, il faudrait donc recruter des sujets purement dyscalculiques, c’est-à-dire connaître déjà les caractéristiques définitoires de la dyscalculie !
3) L’approche par les Temps de Réponse
Si la dyscalculie est due à un dysfonctionnement neurologique, éventuellement d’origine génétique, on peut émettre l’hypothèse d’une défaillance de certains processus numériques basiques chez les sujets dyscalculiques. Un de ces processus basiques, est la comparaison de nombres à un chiffre. Chez l’adulte, ne présentant pas de difficulté dans le domaine numérique, on a mis en évidence un effet de congruence qui peut affecter la vitesse de comparaison de deux nombres. Dans la tâche typique conduisant à cet effet, les sujets doivent indiquer le côté où se trouve le stimulus le
plus grand, soit numériquement, soit physiquement.
Dans sa composante interférence, l’effet de congruence s’observe, par exemple, par une comparaison plus lente de 4 à 2, si 2 est écrit en plus grand que 4 (cf. partie gauche de la figure 1), comparativement à une condition neutre ; dans sa composante facilitation, il s’observe par une comparaison plus rapide de 4 à 2, si 2 est écrit en plus petit que 4 (cf. partie droite de la figure 1), comparativement à une condition neutre. L’effet de congruence traduit l’interaction de la magnitude des nombres avec leur taille d’écriture. Il suggère une activation automatique du nombre car le sujet
n’arrive pas à inhiber cette activation quand il devrait l’ignorer, c’est-à-dire quand on lui demande de comparer la taille physique.

Cet effet a été observé chez les jeunes enfants à développement arithmétique typique dès la deuxième année d’école. Récemment, dans une version non symbolique (cf. la figure 2), Gebuis et al. (2009) l’ont même observé sur des enfants de 5 ans :
ils mettent 40 ms (en moyenne) de moins pour indiquer le côté des gros points sur des configurations comme celles de la figure 2b (où les gros points sont aussi les plus nombreux) que sur des configurations comme celles de la figure 2a (où les nombres des gros et petits points ont été égalisés) ; ils mettent également 93 ms (en moyenne) de moins pour indiquer le côté des gros points sur des configurations comme celles de la figure 2a que sur des configurations comme celles de la figure 2c (où ce sont les petits points qui sont les plus nombreux) [3].

Comme ces composantes – facilitation ou interférence – de l’effet de congruence sont engendrées par des traitements numériques basiques et automatisés, on peut penser que, chez l’enfant qui ne les présente pas, ces traitements basiques et automatisés sont absents ou insuffisants. Une telle absence ou insuffisance d’un traitement numérique basique pourrait conduire à des difficultés dès que les traitements numériques deviennent un peu plus complexes. D’où l’idée d’étudier un tel effet, ou des effets analogues, pour détecter une dyscalculie.
Mais, pour être complet, il faudrait vérifier en outre que les sujets qui ne présentent pas l’effet de congruence pour les comparaisons numériques, présentent un tel effet dans d’autres domaines. Rubinsten et Henik (2006) ont suggéré une méthode astucieuse se basant sur le balancement de notre système perceptif entre perceptions locale et globale. En adaptant leur matériel (en hébreu originellement), on peut voir sur la figure 3 que le S écrit avec des Z devrait conduire à une interférence entre les S et Z (du fait de leur similarité phonémique), mais pas entre les S et A, chez les sujets à qui l’on demande d’identifier les petites lettres et chez qui les activations phonologiques par les lettres sont automatiques. Pour être classé dyscalculique, un sujet ne devrait donc pas être sensible aux effets induits par la différence de taille de la présentation des stimuli numériques à comparer, mais devrait en revanche montrer l’effet d’interférence avec les lettres. Une telle méthode n’a été mise en oeuvre qu’avec des adultes (Rubinsten & Henik, 2006).

Plusieurs réserves peuvent être formulées à l’égard de ces approches par les temps de réponse. D’abord, leur caractère limité en dépit de leur complexité. Par exemple, avec la méthode suggérée par Rubinsten et Henik, on ne teste que la dyslexie phonologique : pour éliminer les autres dyslexies, ou la dysorthographie, dysphasie, etc., il faudrait encore d’autres vérifications. Ensuite, il n’est pas sûr que l’inefficience des traitements numériques basiques soit la cause, plutôt que la conséquence, d’une insuffisance de la pratique numérique. Enfin, l’on voit mal en quoi l’insuffisance d’une activation automatique de la magnitude d’un nombre entier pourrait entraver la
plupart des compréhensions ultérieures en mathématiques, par exemple celle du calcul algébrique. D’ailleurs, sur des élèves de cinquième et sixième année (CM2 et Sixième en France), Schneider et al. (2009) ont établi, avec un matériel de fractions décimales, que d’autres effets censés résulter de l’activation automatique de la représentation des nombres sur une ligne numérique mentale, ne prédisent pas le niveau de l’élève, au contraire de la connaissance conceptuelle, de l’intelligence numérique et de l’estimation sur une ligne numérique physique. Dans le même ordre d’idées, on voit mal en quoi la faiblesse des processus basiques peut expliquer la dyscalculie chez les étudiants avancés. C’est la raison pour laquelle j’ai pu proposer (Fischer, 2009a) que la faiblesse ou la défaillance du processus d’abstraction réfléchissante (Piaget, 1977), spécifique aux mathématiques et mis en oeuvre à tous les âges, semblait plus à même de rendre compte d’un trouble, spécifique et affectant tous les âges, comme la dyscalculie.
4) Qu’en est-il de la possible origine génétique de la dyscalculie ?
Trouver un gène de la dyscalculie conduirait certainement à une méthode indiscutable d’identification des sujets dyscalculiques. Mais on en est loin. Les arguments actuellement avancés en faveur d’une origine génétique sont indirects et discutables. Ainsi :
- L’étude des jumeaux d’Alarcon et al. (1997) conduit à 57.5% de paires concordantes chez les jumeaux monozygotes et 39.1% chez les jumeaux dizygotes : la direction de cette différence est certes en accord avec l’hypothèse génétique, mais la différence n’est pas statistiquement significative.
- L’étude des familles par Shalev et al. (2001) : 66% des mères, 40% des pères, 53% des frères et soeurs, et 44% de parents de second degré de sujets dyscalculiques sont dyscalculiques. Mais, avec ce type d’argument, on arriverait à la quasi-certitude de la transmission génétique de la religion !
- Les maladies génétiques (e.g., trisomie 21, syndrome de Turner, syndrome de l’X fragile) conduisent fréquemment à des difficultés en calcul. Mais ces difficultés résultent d’un trouble plus général et donc n’affectent pas que le seul calcul.
En outre, l’origine génétique est difficilement compatible avec de nombreuses observations qui montrent que la dyscalculie n’est pas un état permanent. Par exemple, Shalev et al. (2005) ont identifié des sujets dyscalculiques en cinquième année d’école : six ans après, seulement 40% d’entre eux étaient encore dyscalculiques.
Enfin, en étudiant la dyscalculie à l’âge adulte, avec la même méthodologie que celle utilisée avec les élèves de CE2 et de Sixième, nous avons estimé, à partir des données de l’enquête IVQ 2004 (Information sur la Vie Quotidienne) de l’Insee, à près de 3% le pourcentage de personnes adultes (de 18 à 65 ans) potentiellement dyscalculiques (Fischer & Charron, 2010). Un tel pourcentage est supérieur à celui établi sur les élèves. Si l’on écarte la possibilité que cette supériorité proviendrait de nombreuses dyscalculies acquises (les sujets à lésion neurologique n’avaient que peu de chances de participer à l’enquête de l’Insee), l’interprétation la plus plausible est que certains sujets adultes, lorsqu’ils sont davantage libres de leurs choix (au contraire des élèves de l’école ou du collège à qui l’on impose une quantité importante d’activités numériques), ne pratiquent plus guère le calcul numérique lorsqu’il n’est pas nécessaire à leurs activités professionnelles ou autres (suivi du travail scolaire des enfants, loisirs, …). Comme, par ailleurs, notre société, de par les facilités qu’elle nous offre, incite de moins en moins aux calculs et raisonnements numériques (par exemple, l’affichage des prix unitaires dans les commerces nous évite de faire des divisions ou des raisonnements de proportionnalité), ces adultes n’ont plus guère de pratique numérique. Une telle explication de la dyscalculie par l’absence de pratique va à l’encontre de son origine génétique.
5) La notion de dyscalculie présente-t-elle un intérêt pédagogique ?
L’intérêt pédagogique majeur d’une notion comme la dyscalculie serait la mise au point de programmes spécifiques de remédiation. Cet intérêt est cependant doublement entravé par l’absence de méthode de repérage incontestable des sujets dyscalculiques. D’une part, on ne connaît pas sûrement les élèves à qui appliquer les programmes de remédiation ; d’autre part, ces derniers sont difficiles à évaluer faute d’arriver à constituer des échantillons d’élèves indiscutablement dyscalculiques. D’ailleurs, dans l’évaluation de leur programme (informatique) de remédiation de la dyscalculie (« La course aux nombres »), Wilson, Dehaene et al. semblent aujourd’hui préférer la
circonlocution « enfant à faibles habiletés numériques » au qualificatif « dyscalculique » (voir Räsänen et al., 2009).Quant au contenu des programmes que j’ai pu examiner (Fischer, 2009a), il peut convenir à n’importe quel élève faible ou en cours d’apprentissage. En fait, les résultats de ces remédiations soulignent surtout l’importance de la compréhension conceptuelle et de la compétence en estimation. Cela est aussi un des enseignements que tirent Schneider et al. (2009) de leurs études ou moi-même du dossier sur la dyscalculie développementale que j’ai coordonné (Fischer, 2009b).
Dans les conclusions de ce dossier, l’importance de la composante « estimation » est apparue principalement à travers la contribution de Vilette (2009). Le programme informatisé de remédiation mis au point par ce dernier insiste en effet, non pas simplement sur l’intérêt de l’estimation, mais sur une double approche – par l’approximation et le calcul exact – des additions et soustractions élémentaires. Or, de manière plus générale, l’efficacité de deux (ou plus) approches différentes d’un même concept est maintenant largement attestée. Par exemple, Rittle-Johnson et Star (2009) ont comparé, sur 162 élèves de septième et huitième année (donc de Cinquième et Quatrième de collège en France), l’apprentissage de la résolution d’équations par comparaison de : (a) problèmes équivalents avec la même méthode de solution, (b) différents types de problèmes avec la même méthode de solution, ou (c) différentes méthodes de solution du même problème. Leur conclusion est que la comparaison de méthodes de solution conduit aux meilleures connaissances conceptuelles et flexibilités procédurales.
Comme le suggère ma « dérivation » ci-devant vers un principe général de l’apprentissage, je conclurai en observant que la notion de dyscalculie a incontestablement stimulé la recherche mais ne semble pas avoir apporté, à ce jour, d’idées pédagogiques nouvelles, efficaces et spécifiques, pour l’aide aux élèves présumés dyscalculiques.
Références
Alarcón M., DeFries J.C., Light J.G., & Pennington B.F. 1997. A twin study of mathematics disability. Journal of Learning Disabilities, 30, 617-623.
Fischer J.-P., 2007. Combien y a-t-il d’élèves dyscalculiques ? A.N.A.E., 19, 141- 148.
Fischer J.-P., 2009a. Six questions ou propositions pour cerner la notion de dyscalculie développementale. A.N.A.E., 21, 117-133.
Fischer J.-P., 2009b. La dyscalculie développementale : une conclusion. A.N.A.E., 21, 179-185.
Fischer J.-P., 2009c. La dyscalculie développementale : une notion – à tort ou à raison – délaissée par les enseignants de mathématiques. MathémaTICE, no 16,
(http://revue.sesamath.net/spip.php?article237).
Fischer J.-P. & Charron C., 2010. Une étude de la dyscalculie à l’âge adulte. Économie et Statistique, no 424-425, 87-101.
Gebuis T., Cohen Kadosh R., de Haan E. & Henik A., 2009. Automatic quantity processing in 5-year olds and adults. Cognitive Processing, 10, 133-142.
Kaufmann L., Vogel S.E., Starke M., Kremser C., Schocke M. & Wood G., 2009. Developmental dyscalculia : compensatory mechanisms in left intraparietal regions in response to nonsymbolic magnitudes. Behavioral and Brain Functions, 5 (35) (http://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/5/1/35).
Kosc L., 1974. Developmental dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 7, 164-177.
Piaget J., 1977. Recherches sur l’abstraction réfléchissante : 1/ L’abstraction des relations logico-arithmétiques. Paris : PUF.
Räsänen P., Salminen J., Wilson A.J., Aunio P. & Dehaene S., 2009. Computerassisted intervention for children with low numeracy skills. Cognitive Development, 24, 450-472.
Rittle-Johnson B. & Star J.R., 2009. Compared with what ? The effects of different comparisons on conceptual knowledge and procedural flexibility for equation solving. Journal of Educational Psychology, 101, 529-544.
Rubinsten O. & Henik A., 2006. Double dissociation of functions in developmental dyslexia and dyscalculia. Journal of Educational Psychology, 98, 854-867.
Schneider M., Grabner R.H. & Paetsch J., 2009. Mental number line, number line estimation, and mathematical achievement : Their interrelations in grades 5 and 6. Journal of Educational Psychology, 101, 359-372.
Shalev R.S., Manor O. & Gross-Tsur V., 2005. Developmental dyscalculia : a prospective six-year follow-up. Developmental Medicine and Child Neurology, 47 (2), 121-125.
Shalev R.S., Manor O., Kerem B., Ayali M., Badichi N., Friedlander Y. & Gross-Tsur V., 2001. Developmental dyscalculia is a familial learning disability. Journal of learning disabilities, 34, 59-65.
Vilette B., 2009. L’Estimateur : un programme de remédiation des troubles du calcul. A.N.A.E., 21, 165-170.
<redacteur|auteur=500>