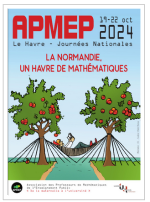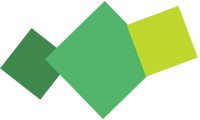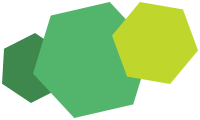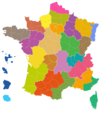275-276
275-276. L’évolution des modèles mathématiques en mécanique et en physique.
par J. M. SOURIAU
(Faculté des Sciences d’Aix-Marseille)
Depuis l’antiquité grecque jusqu’à la fin du XIX° siècle, l’histoire de la
physique a pu se décrire comme une succession de découvertes venant peu à peu
s’ajouter les unes aux autres.
En deux millénaires, la pensée philosophique et la méthode expérimentale,
se relayant, ont progressivement montré que la Nature se conforme à des
Lois, que ces lois sont éternelles, et qu’elles se formulent dans le langage des
Mathématiques.
Ainsi Aristote avait découvert les lois de la logique ; Euclide celles de
l’Espace ; après la coupure du Moyen Age, Newton avait découvert les lois
de la Mécanique ; bien des découvertes ultérieures s’étaient résumées dans la
synthèse prodigieuse de Maxwell, donnant leur formulation définitive aux
lois de l’Électricité, du Magnétisme et de l’Optique.
Ces équations de Maxwell, mathématiques par essence, constituent le
seul lien intelligible entre les concepts de l’électro-magnétisme et ceux de
l’optique ; bien plus, elles démontrent que ces concepts différents recouvrent
une structure unique ; on sait que cette découverte purement intellectuelle
devait être triomphalement confirmée par l’émission et la réception des ondes
de radio.
Ainsi, il y a un siècle, la Mathématique s’affirmait comme la reine des
sciences ; non seulement parce qu’elle constituait le langage même de la nature ;
mais aussi parce qu’elle assurait la stabilité définitive des découvertes scientifiques ;
la géométrie d’Euclide, par exemple, est un édifice immuable, alors
que toute doctrine philosophique est sujette à une perpétuelle révision .
Quelques esprits pénétrants - et subversifs - avaient pourtant compris
que cette solidité même de la science n’était en réalité que de la raideur et
qu’il était possible de s’en dégager.
Ainsi, par simple nécessité éthique, certains avaient construit des variantes
sacrilèges de la géométrie d’Euclide - ce qu’on appelait les « géométries
non-euclidiennes ». Mais la plupart des savants considéraient ces recherches
comme de simples curiosités mathématiques ; il s’écoula un demi-siècle avant
que se produise une véritable mue de la physique ; ce n’est que dans les années
1900 que la science fut obligée de rejeter sa carapace et d’entrer dans une
période d’aventure - tout comme un simple crustacé qui veut grandir.
Cette opération ne se fit pas sans douleur ; il est fort instructif à ce sujet
d’observer l’accueil qui fut fait à la théorie de la relativité ; accueil enthousiaste
de ceux qui y découvriraient la solution d’énigmes irritantes ; accueil
horrifié de ceux qui n’y voyaient que paradoxes et négations. De nos jours
encore, des autodidactes et des polytechniciens retraités publient à compte
d’auteur des réfutations d’Einstein - sans s’émouvoir d’un demi-siècle d’utilisation
pratique de la relativité.
Ce sentiment d’horreur n’est pas complétement injustifié ; effectivement,
il est impossible d’admettre la théorie de la relativité sans détruire une partie
de l’édifice antérieur de la science.
Nous connaissons aujourd’hui le bilan exact de cette destruction : le
concept de loi a disparu ; il a été remplacé par le concept de modèle
Ainsi, pour le physicien de 1970, la mécanique de Newton et celle d’Einstein
ne sont pas en contradiction : ce sont des modèles différents, que l’on
utilise alternativement, selon la catégorie de phénomènes que l’on veut étudier.
Le rôle des mathématiques en physique s’est donc diversifié et nuancé :
on ne leur demande plus de « décrire les lois de la nature », mais d’assurer la
cohérence logique et la puissance déductive de chacun des modèles qui servent
à étudier la nature.
Beaucoup de physiciens croient, aujourd’hui, que cette quête des modèles
est essentiellement infinie - aucun des modèles possibles ne pouvant prétendre,
à lui seul, à une description parfaite de la nature.
Dans une telle perspective, le progrès de la science ne peut plus être linéaire,
chaque découverte venant s’ajouter simplement aux précédentes ; il
emprunte nécessairement une démarche dialectique, que nous allons décrire
schématiquement.
Chaque fois que les champs d’application de deux modèles différents A et B
se recoupent, le physicien est tenu d’analyser les rapports de chaque modèle
avec
l’expérience, avec suffisamment de finesse pour les promouvoir au plan
des théories, ce qui doit permettre d’établir une correspondance entre les
modèles A et B.
La nature de cette correspondance mérite d’être méditée : il peut s’agir
d’un simple isomorphisme, partiel en général ; dans ce cas les deux modèles
pourront se raccorder (parfois au prix d’un changement de formulation pour
l’un ou l’autre, qu’il faut d’ailleurs découvrir) ; ils seront alors englobés dans
un modèle unique C.
Mais ce n’est pas toujours le cas ; sinon la fusion successive des différents
modèles aboutirait à une physique unique, limite inductive des différents
modèles ; et c’est justement ce que la nature semble nous refuser.
Il y a donc des cas où l’on se trouve dans une situation méta-mathématique :
le dialogue entre A et B n’est pas de nature mathématique, puisque la contradiction
logique entre A et B est irréductible ; et pourtant A et B sont chacun
une construction purement mathématique.
Cette situation peut sembler intolérable à un mathématicien pur ; mais
elle est le lot obligé du physicien théoricien.
Cet état de crise logique n’est d’ailleurs qu’un stade du progrès des connaissances ;
il prend fin lorsque quelqu’un a imaginé un modèle synthétique X,
permettant de décrire la Nature aussi bien que A et B dans leurs domaines
respectifs d’application ; on peut alors renvoyer A comme B dans les limbes de
l’histoire des sciences, et prendre X comme nouveau point de départ.
C’est donc l’imagination créatrice qui permet de résoudre les contradictions
successives de la physique théorique ; elle ne suffit d’ailleurs pas : il est nécessaire
que l’ensemble des physiciens accepte de renoncer aux modèles antérieurs,
parfois fort vénérables et plongeant des racines dans la culture et les
croyances les mieux établies ; en tous cas, les spécialistes doivent être moralement
prêts à renoncer à des pans entiers de leurs connaissances, parfois à
tout ce qui a fait naguère leur renommée personnelle.
Certains peuvent arguer de la valeur pratique indéniable - des modèles
anciens pour continuer à penser et à travailler avec eux ; mais ils se coupent
alors du courant vivant de la recherche, et ne peuvent plus prétendre diriger
ou inspirer les travaux de leurs élèves.
Parfois cette crainte est si forte qu’il se produit un excès contraire sitôt
que quelqu’un a ébranlé une théorie explicative, tous l’abandonnent sans
l’avoir approfondie suffisamment ; il semble que la physique théorique contemporaine
souffre beaucoup de son goût excessif pour la mode.
Ces renoncements successifs sont l’un des traits les plus caractéristiques
du développement scientifique contemporain ; ce sont eux qui permettent les
progrès les plus spectaculaires des connaissances, car un modèle nouveau a
trouvent un champ d’application plus vaste que ceux dont la crise de compatibilité lui a donné naissance.
II est impossible d’analyser ici des exemples en détails ; rappelons seulement
la relation d’Einstein $E = mc^{2}$ ; fruit du dialogue entre la mécanique
classique et la mécanique relativiste (1905) ; on sait que cette relation a permis
de
prévoir l’énergie utilisable de prévoir l’énergie utilisable dans les réactions nucléaires, et de comprendre
pourquoi le Soleil brille.
De même les extraordinaires progrès actuels de l’optique ne sont possibles
que parce qu’Einstein, dans la même année 1905, proposait le modèle du
photon, particule de lumière ; modèle qui contraignait à renoncer aux équations
de Maxwell comme seule explication de l’optique.
A l’heure actuelle, on n’a pas réussi à établir de correspondance satisfaisante
entre la mécanique quantique et ce qu’on appelle parfois la théorie
classique des champs (et qui contient notamment la relativité générale) ; c’est
une situation d’autant plus irritante que chacun des modèles a recueilli d’innombrables
succès théoriques et expérimentaux, et que cette moisson continue
aujourd’hui. Les espoirs de synthèse que l’on attendait de la « théorie quantique
des champs ", fondée il y a plus de trente ans, sont devenus bien minces,
malgré de brillants succès passagers. On peut espérer que la résolution du
problème dialectique ainsi posé permettra de sortir de l’impasse où la physique
théorique est enfermée aujourd’hui ; peut-être même d’expliquer les phénomènes
prodigieux dont les astrophysiciens sont actuellement les témoins
dans notre galaxie et au-delà (pulsars, quasars, explosions galactiques).
La notion de modèle n’est pas seulement un instrument prospectif : elle
permet aussi de jeter des regards neufs sur le passé.
En effet, si le développement linéaire de la science est impossible à l’heure
actuelle, c’est qu’il l’a toujours été ; la croyance régnant le plus communément
il y a un siècle était donc une illusion, plaquée sur l’histoire réelle des
sciences pour éviter d’y voir des situations apparemment inadmissibles.
Or l’enseignement d’aujourd’hui reflète très souvent des croyances épistémologiques
très anciennes ; si ces croyances étaient illusoires, le contenu même
de notre enseignement doit être révisé.
C’est pourquoi je vais vous proposer quelques exemples d’analyse historique ;
les conclusions auxquelles je parviendrai sont probablement discutables :
je ne les propose que comme thèmes de réflexion. Le jeu est ouvert à tous,
et il est fructueux.
Citons un ouvrage apprécié, publié en 1950, l’Histoire de la Mécanique
de René Dugas. Il commence par ces lignes :
« Toute histoire de la mécanique, faute sans doute de pouvoir remonter
plus avant, commence à Aristote (384-322 avant J.-C.).
L’auteur ne fait donc aucune allusion au plus remarquable des modèles de
la mécanique, qui est antérieur à Aristote : c’est le modèle atomique, élaboré
par Démocrite (né vers 460 avant J.-C. à Abdère, au nord de la mer Égée) et
probablement par d’autres « atomistes »de la même école, tels que Leucippe de
Milet.
Les fragments de Démocrite qui nous sont parvenus sont fort clairs ;
pour lui, les atomes sont les constituants ultimes de la matière - infiniment
durs et par conséquent impossibles à couper, d’où leur nom ; il existe une
infinité de type d’atomes ; et pour chaque type, une infinité d’exemplaires
indiscernables ; ce sont les combinaisons de ces atomes entre eux qui sont
responsables des apparences sensibles ; ce qui se résume en une formule admirable
et parfaitement actuelle :
« nous disons chaud, nous disons froid,
nous disons sucré, nous disons amer, nous disons couleur ; mais il n’existe
en réalité que les atomes et le vide ».
A condition de traduire le mot « atome » pat le mot « particule élémentaire"
, toutes les affirmations de Démocrite sont valables aujourd’hui, ainsi
les physiciens savent que les particules d’un même type sont indiscernables
(les conséquences de cette indiscernabilité se vérifient expérimentalement en
physique statistique) ; ils croient que la construction de grands accélérateurs
permettra de découvrir de nouveaux types de particules, sans que l’on puisse
assigner une limite à ces découvertes.
Il ne faudrait pas pour autant oublier que les atomes ne sont que l’un des
aspects du modèle de Démocrite ; l’autre est le vide, dans lequel les atomes
ont un mouvement perpétuel ; « vide infini où il n’y a ni haut, ni bas, ni milieu,
ni extrémité » écrit Démocrite.
Toutes ces caractéristiques négatives du vide sont évidemment une mise en
garde contre le sens commun et contre d’autres opinions de l’époque ; mise en
garde qui n’a pas empêché d’ailleurs le triomphe durable de la réaction qui
s’exprime avec force dans l’œuvre d’Aristote. Rappelons simplement que,
pour Aristote, tout mouvement est destiné à s’arrêter ; qu’il existe des « lieux
naturels » pour toutes choses, le bas pour les corps pesants, le haut pour les
corps subtils ; que l’univers est fini et la matière indéfiniment divisible ; etc.
Cependant, l’affirmation de Démocrite selon laquelle le vide n’a ni haut,
ni bas, ni milieu, ni extrémité peut aussi nous apparaître comme une préfiguration
des concepts modernes d’isotropie et d’homogénéité : puisqu’il n’y a ni
haut, ni bas, l’espace vide peut se retourner sans cesser d’être semblable à
lui-même ; de même, puisqu’il n’a pas de milieu, une translation ne l’altère pas.
Ce sont ces idées qui seront exploitées par les géomètres grecs, avec le succès
que l’on sait, et qui aboutiront aux Éléments d’Euclide. Idées qui ont conduit
beaucoup plus tard à la classification des géométries par Félix Klein dans son
« programme d’Erlangen » (1872) au moyen d’un groupe quelconque opérant
sur un ensemble ; ainsi se généralise le rôle du groupe des déplacements euclidiens
opérant sur l’espace classique.
Nous savons aujourd’hui que la géométrie d’Euclide n’est qu’un modèle ;
mais c’est le « modèle des modèles » , puisque c’est son imitation qui a permis
l’élaboration des concepts unificateurs de la mathématique et de la physique
d’aujourd’hui ; notamment la théorie des groupes et, plus généralement, la
notion de morphisme qui permet enfin de dire avec précision ce que l’on entend
par une « structure » mathématique (précision qui semble encore échapper
au « structuralisme » tel qu’il est conçu dans les sciences humaines).
Notons un autre aspect caractéristique des modèles mathématiques qui
est en évidence dans Je cas de la géométrie d’Euclide ; le caractère paradoxal,
provocant, des simplifications qu’ils comportent.
Alors que l’espace d’Aristote était un tissu compliqué, comportant à la
fois
des morceaux continus et des points - définis d’ailleurs comme frontières
de régions continues - l’espace d’Euclide est simplement un ensemble de
points - le premier ensemble, probablement, qui ait été considéré pour lui-même.
C’est cette simplicité de structure qui est choquante : les problèmes
ardus posés par la définition directe d’un point, par la possibilité de « remplir »
l’espace par des points sans dimension, n’ont évidemment pas échappé aux
géomètres grecs ; mais ils les négligent allègrement - prouvant par le succès
de la géométrie que ces problèmes sont effectivement négligeables ou, en
tous cas, qu’on peut les remettre à plus tard ; c’est en effet beaucoup plus tard
que les problèmes du continu furent résolus, par la construction des nombres
réels,œuvre du XIX" siècle.
L’accord profond des géomètres et des atomistes est évident : Aristote,
pour qui la matière était infiniment divisible, ne pouvait concevoir que l’espace
soit « composé » de points, atomes d’espace, eux-mêmes indivisibles.
Or, les connaissances que nous avons aujourd’hui de la psychologie de
l’enfant, notamment grâce aux travaux de Piaget et de son école, permettent
de penser que l’audace des simplifications euclidiennes est un obstacle important
à la compréhension de la géométrie : peut-être est-il nécessaire de ménager
des transitions entre un stade « aristotélicien » de la pensée de l’enfant et un
stade " euclidien » auquel nous voulons l’amener .
C’est évidemment une naïveté de dire que les outils de pensée dont nous
disposons aujourd’hui auraient permis à la science classique de progresser
beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’a fait ; mais certaines circonstances
historiques donnent tellement l’impression d’avoir été des occasions manquées
qu’il est tentant d’essayer de deviner comment les sciences auraient évolué si,
certain jour, un simple effort d’imagination créatrice avait permis un progrès
décisif qui ne devait avoir lieu, dans la réalité, que beaucoup plus tard.
Je voudrais citer un exemple ; non pour le simple plaisir de faire de l’« épistémologie-
fiction », mais parce que les progrès qui n’ont pas eu lieu dans
l’histoire des sciences peuvent encore être faits dans l’enseignement des sciences.
Le but déclaré de Newton était d’édifier une mécanique qui soit une
véritable géométrie globale de l’espace et du temps. Citons-le :
« La géométrie n’est autre chose qu’une branche de la Mécanique
universelle qui traite et qui démontre l’art de mesurer » « les artisans
ont coutume d’opérer pen exactement, de là est venu qu’on a tellement
distingué la Mécanique de la Géométrie, que tout ce qui est exact s’est
rapporté à celle-ci, et ce qui l’était moins à la première ), ...« nous qui
avons pour objet, non les Arts, mais l’avancement de la Philosophie,
nous proposons ce que nous donnons ici comme les principes mathématiques
de la philosophie naturelle. » (Préface de la première édition des
« philosophiae naturalis principia mathematica ». 8 mai 1686.)
Le programme de Newton n’a été réalisé complétement que plusieurs siècles
plus tard ; contrairement à une opinion répandue, il était possible de le faire
par des moyens entièrement classiques - sans faire appel à la relativité d’Einstein.
Il suffit en effet de considérer le produit cartésien de l’espace et du temps,
c’est-à-dire l’ensemble des couples (

étant un point de l’espace, t une
date ; puis d’étudier les permutations de cet ensemble espace-temps qui sont
données par la formule :

D étant un déplacement euclidien, ${v}$ une vitesse, h une durée.
Ces permutations s’appellent aujourd’hui - à juste titre -les transformations
de Galilée ; c’est un exercice élémentaire de vérifier qu’elles constituent
un groupe, le groupe de Galilée ; la géométrie galiléenne est l’étude des propriétés
invariantes par les transformations du groupe.
Il se trouve que la relation fondamentale de Newton

est invariante
par les transformations de Galilée ; ce qui laisse à penser que toute la
mécanique classique possède cette invariance ; en d’autres termes que la mécanique
classique peut se formuler dans le langage de la géométrie galiléenne.
C’est cette hypothèse que Poincaré appelait le « principe de relativité »,
et que l’on nomme aujourd’hui « principe de relativité galiléenne » , pour
éviter toute confusion avec la théorie d’Einstein.
En géométrie galiléenne, un mobile en repos et un mobile en mouvement
rectiligne uniforme constituent des figures égales ; ce qui est implicitement
contenu dans le principe de l’inertie, formulé par Galilée, qui donne justement
le même statut physique au repos et au mouvement rectiligne uniforme.
L’espace au repos est donc une notion pré-galiléenne, à laquelle il faut
renoncer. Il n’est pas sur que les scientifiques d’aujourd’hui en aient tous
conscience ; en tous cas Newton n’a pas pu s’y résoudre, malgré l’embarras que
trahit l’énoncé même de ses « définitions » , il écrit tantôt « l’espace absolu
demeure toujours similaire et immobile » et tantôt « il faut avouer qu’il est
très difficile de connaître les mouvements rais de chaque corps...parce que les
parties de l’espace immobile ne tombent pas sous nos sens » ... « il peut se
faire qu’il n’y ait aucun corps véritablement en repos ".
Par d’autres écrits, nous connaissons les causes de la répugnance de Newton
à accepter la relativité galiléenne ; elles sont pour l’essentiel théologiques ;
elles tiennent aussi, probablement, au caractère systématique de son opposition
à Descartes qui, sur ce point particulier, avait une conception plus moderne.
Bien entendu, l’adoption de la géométrie galiléenne aurait tué dans l’œuf
la théorie de l’éther qui a fait perdre tant de temps à la physique ; curieusement,
Newton lui-même met en garde, très sèchement, son lecteur : « je ne fais
point attention ici au milieu qui passe librement entre les parties des corps,
supposé qu’un tel milieu existe ». Il est vrai que l’éther faisait partie de l’arsenal
cartésien ...
De même, cette géométrie galiléenne aurait évité la venue au monde de
notions
qui encombrent encore les traités de mécanique analytique, et qui sont
aussi anachroniques que l’éther : " espace de configuration », « « espace de
phases » par exemple. On sait aujourd’hui comment renoncer à ces vieilleries ;
les nouveaux modèles qui les remplacent sont mieux structurés mathématiquement,
et permettent une interprétation beaucoup plus directe de l’expérience.
Ils permettent aussi de donner corps à une très vieille ambition des philosophes,
que nous allons évoquer rapidement.
Pour Démocrite, il n’était pas question de prévoir les différents types
d’atomes - ceux-ci étant déterminés par la nature selon des lois imprévisibles.
Cependant un prédécesseur de Démocrite s’était hasardé à une telle prédiction :
il s’agit du Sicilien Empédocle, auteur probable de la théorie des quatre éléments
(terre, air, feu, eau), constituants supposés de toute matière. Le choix du
nombre quatre, qui nous semble arbitraire, était probablement rattaché à des
consid6rations géométriques ; nous lisons en effet dans Platon (Le Timée)
que ces éléments se rattachent chacun à l’un des polyèdres réguliers connus
(cube, octaèdre, tétraèdre, icosaèdre) ; la découverte d’un cinquième polyèdre
(le dodécaèdre) fit aussitôt imaginer un cinquième élément, qui apparaît
déjà dans Platon et Aristote, et qui eut une belle carrière médiévale sous
le nom de quinte essence.
Il apparaît là une volonté manifeste de prévoir les propriétés de la matière
à partir des propriétés géométriques de l’espace vide ; d’établir, en un sens,
une dialectique du vide et de la matière.
Remarquons que cette dialectique rêvée met en jeu, implicitement, le
groupe des rotations de l’espace : en effet l’existence des polyèdres réguliers est
liée à l’existence des sous-groupes finis non commutatifs de ce groupe.
Or les conceptions modernes de la mécanique théorique permettent de
réaliser un programme analogue ; la possibilité de faire opérer le groupe de
Galilée sur l’espace des mouvements d’un système matériel permet, par un
jeu assez subtil, de prévoir l’existence des grandeurs caractéristiques de la
matière : énergie, impulsion, moment cinétique, centre de gravité. masse ;
cette méthode permet aussi de classer les particules élémentaires, au moyen
de leur masse et de leur spin ; rappelons combien l’existence du spin de l’électron
a semblé paradoxale lors de sa découverte en 1927 : on l’interprétait comme
un mouvement de rotation de l’électron sur lui-même, mouvement dont
aucune action extérieure ne pouvait modifier l’intensité ; nous voyons maintenant
que cette propriété était prévisible par une analyse correcte des principes
de la mécanique classique.
Notons au passage que la situation n’est guère modifiée si l’on passe de la
mécanique classique à la mécanique relativiste (il suffit de changer de groupe) ;
mais de nouveaux types de particules apparaissent ; en particulier des particules
de masse nulle, se mouvant à la vitesse de la lumière, pourvues de spin, ainsi
que d’une propriété nouvelle, l’hélicité qui leur confère une orientation spatiale ;
il se trouve que cette description convient parfaitement aux photons,
les atomes de lumière découverts par Einstein (ils sont polarisés à droite ou à gauche selon leur hélicité) ; ainsi l’optique peut-elle entrer dans le cadre de
la mécanique, selon le vœu de Newton.
Enfin, et surtout, la géométrie galiléenne, si elle avait été comprise assez
tôt, aurait permis de chasser bien des idées fausses qui encombrent encore
le langage et la pensée du grand public et même des scientifiques ; combien
soupçonnent aujourd’hui que les notions de trajectoire d’un mobile, de vitesse
d’un corps dans l’espace, de distance parcourue par une fusée sont des notions
pré-galiléennes auxquelles il est rigoureusement impossible d’attacher une
signification précise, à moins de considérer comme un dogme la référence à la
Terre immobile ?
Il serait peut-être temps, au bout de 400 ans, que les concepts issus de
la pensée de Galilée fussent effectivement enseignés dans les lycées et les
universités. Cet effort présenterait divers avantages : permettre aux futurs
physiciens un accès plus commode aux théories actuelles ; rendre chacun apte
à comprendre la mécanique spatiale, qui est maintenant une donnée immédiate
de la culture ; permettre au public de comprendre, sur un exemple essentiel,
l’un des traits caractéristiques de la pensée scientifique actuelle.
<redacteur|auteur=13>