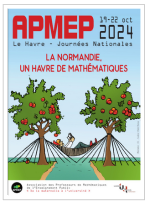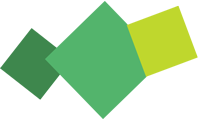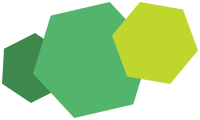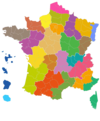472
Ils doivent savoir calculer.
L’article ci-après est un extrait d’un texte paru, en 1989, dans le n° 70 de la revue belge
« Mathématique et Pédagogie ».
En 1989 ! Mais ce qu’il fustige ne nous est-il pas une perpétuelle tentation ? … Son intérêt
ne paraît donc démodé ni aux yeux de l’auteur, ni aux nôtres.En remerciant Nicolas Rouche et
« Mathématique et Pédagogie » de nous y autoriser, nous vous le proposons ainsi comme base
de réflexion avec, toujours, les mêmes espérances, la même foi en d’heureuses pratiques
innovantes faisant tache d’huile.Bruno ALAPLANTIVE, Henri BAREIL et Christiane ZEHREN
Nicolas Rouche [1]
1. Tant de temps passé sans penser ...
L’activité calculatoire est importante en mathématiques. Elle est peut-être la
partie la plus visible de cette science, comme en témoigne l’homme de la rue
lorsqu’il confond, ce qui lui arrive souvent, mathématiques et calcul.
Mais qu’est-ce que calculer ? C’est combiner des symboles suivant des règles
dans un but déterminé. Il y a deux aspects au calcul : il faut d’une part choisir et
ordonner les opérations à faire pour arriver au résultat (c’est-à-dire concevoir
l’algorithme), et d’autre part exécuter les opérations en suivant l’algorithme et en
obéissant strictement aux règles. Seule la conception de l’algorithme peut comporter
des choix et donc des décisions : il y a de ce point de vue des calculs qui mobilisent
beaucoup de pensée tactique. L’exécution des opérations, de son côté, ne laisse
aucune marge de manœuvre : c’est effectivement une tâche d’exécution.
Venons-en maintenant au constat sur lequel le présent exposé voudrait amener à
réfléchir. On passe dans les écoles, à tous les niveaux, un temps considérable à
s’entraîner à calculer selon des algorithmes soit étroitement imposés, soit à faible
marge de manœuvre. Il serait faux de dire que l’on fait cela dans toutes les classes,
mais il est certain qu’on le fait dans beaucoup. Et d’ailleurs, les manuels prévoient
largement ce genre d’entraînement : on y trouve proposées de nombreuses colonnes
de calculs de ce type. C’est ce qu’on appelle souvent le drill. Le mot anglais drill a
d’abord une signification militaire : il désigne l’exercice qui consiste pour les soldats
à évoluer en suivant strictement les règles de décomposition du demi-tour à droite,
du porter-arme, etc.
Outre qu’ils comportent peu de liberté de manœuvre algorithmique, les calculs
dont nous parlons ne sont issus d’aucun problème, les symboles manipulés ne
renvoient à rien sinon, abstraitement, à des nombres ou des fonctions, aucune question n’a été posée au préalable à laquelle le calcul apporterait un élément de
réponse. Ces calculs n’ont pas d’amont. Ils ne viennent de nulle part. Et par
conséquent ils n’ont pas d’aval non plus, ils ne vont nulle part, sauf chez le
professeur qui comptabilise les fautes.
Face à ces activités de calcul les élèves sont en positions diverses. Certains y sont
très habiles et se souviennent, quand il s’agit de symboles littéraux, que ceux-ci
renvoient à des nombres ou des fonctions : en cas de difficulté, ils se donnent un
exemple numérique pour vérifier expérimentalement « comment ça marche ».
D’autres, tout aussi habiles que les premiers, et peut-être doués d’une mémoire plus
solide, exécutent le drill sans faute ou pratiquement, quoique sans savoir ce que les
symboles veulent dire. Ils appliquent aveuglément des règles qui leur apparaissent
comme totalement arbitraires.
D’autres élèves enfin, et on sait qu’ils sont nombreux,
ne réussissent pas à bien faire les calculs, ils font plein de fautes. Comme les
précédents, ils ne savent pas ce qu’ils font, mais en outre ils n’arrivent pas à le faire.
Les élèves de la première catégorie, ceux qui arrivent à calculer et à retourner le
cas échéant des lettres aux nombres, ne mobilisent dans l’activité de drill qu’une
pensée mathématique de courte portée.
Les élèves des deux autres catégories ne
pensent pas du tout sur le plan mathématique. Ils vivent la débâcle du sens. Dans leur
esprit, les symboles ont largué leurs référents. La porte est grande ouverte sur
l’arbitraire. Ils imaginent en calculant les choses les plus farfelues, les plus absurdes.
Beaucoup se mettent à vomir les calculs et, par effet d’entraînement, les
mathématiques. On les envoie à la remédiation, comme s’ils étaient malades, alors
que leur indigestion est sans doute la réaction saine d’un organisme ingurgitant des
arêtes sans chair, des symboles sans référents.
Mais revenons à notre question principale. S’il est vrai d’une part que l’activité
de drill est si répandue, et d’autre part qu’elle mobilise très peu ou pas du tout de
pensée (mathématique), pourquoi passe-t-on tant de temps à ne pas penser ?
2. L’effet du drill
Un premier effet de la pratique intensive du drill concerne les élèves qui n’y
réussissent pas. L’échec en calcul est un facteur, et sans doute non le moindre, de la
sélection scolaire. De nombreux élèves se dégoûtent de l’école, entre autres raisons
parce qu’ils n’ont pas su calculer. Si on admet que les activités de calcul en question
mobilisent peu de pensée, on doit se demander si l’échec en calcul est un critère de
sélection adéquat ou plus simplement acceptable.
Un deuxième effet de la pratique intensive du drill concerne les élèves qui y
réussissent. Certains auteurs ont étudié la question et ont obtenu, selon toute
apparence, des résultats convaincants. On en trouvera mention dans un article de A.
Bell intitulé « Que dit la recherche à propos des méthodes d’enseignement en
mathématique ? » [1]. Bell rapporte et commente dans les termes suivants les résultats
de Brownell et quelques autres : « Brownell en 1975, à la suite de quelque trente
années de recherches intensives consacrées par d’autres à l’usage du drill dansl’apprentissage des faits et de la pratique arithmétique, a commencé à étudier
l’efficacité du drill comparé à des méthodes plus significatives. Il s’agissait de
l’efficacité mesurée non seulement par les performances immédiates des élèves à
l’entraînement, mais par la rétention au long du temps, la compréhension, et le
transfert à des situations quelque peu différentes. Il a montré, dans une série
d’expériences sur l’ enseignement de l’addition puis de la soustraction […], dans
chaque cas par des méthodes significatives et de routine, que, bien que le drill
accroisse effectivement la vitesse de rétention des faits et améliore la capacité
pratique, il n’améliore pas la compréhension des relations, jugée par la capacité de
restituer des faits oubliés à partir de souvenirs d’autres faits, ni la capacité de
transférer l’apprentissage, fut-ce des nombres à deux chiffres aux nombres à trois
chiffres. [Bell renvoie à trois travaux, respectivement de Brownell et Chazal,
Brownell ct Moser, et Williams.] Ce travail peut être résumé comme suit : le drill
améliore la dextérité mais non la compréhension et ses effets s’estompent vite. (C’est
Bell qui souligne).
Bien entendu, l’étude en question porte sur l’arithmétique élémentaire à l’école
primaire. Mais ce n’est pas une mauvaise conjecture que d’étendre ses résultats aux
apprentissages par drill dans les enseignements de tous niveaux, car d’autres études
ont confirmé, pour dire les choses en gros, que les enseignements au cours desquels
les élèves ne pensent pas ou peu leur apprennent peu à penser. (Cf. sur ce point le
reste de l’étude de synthèse de A. Bell). Ce qui, après tout, n’est pas tellement
étonnant…
Mais alors revient la question : pourquoi consacre-t-on encore tant de temps à ce
type d’enseignement inefficace ?
3. Pourquoi continue-t-on ?
Les causes d’un phénomène social sont rarement aisées à identifier, et on n’arrive
jamais à faire le tour d’un problème. Voici quelques hypothèses qui ne manquent pas
de vraisemblance pour expliquer la perpétuation de l’enseignement par drill.
Tout d’abord, l’apprentissage du calcul routinier tend, de lui-même, à se
perpétuer. Quand une génération d’élèves a été élevée dans le drill, elle devient une
génération de parents persuadés que le drill est important et, jusqu’à un certain point,
que, faire des mathématiques, c’est calculer. « Beaucoup d’enfants », écrivent P.
Hilton et J. Pedersen, « conservent dans l’âge adulte la conception fausse qu’il est
dans la nature des mathématiques d’aller d’une tâche assignée, via une méthode
prescrite, vers l’unique “ bonne réponse ”. » « Ils doivent savoir calculer », dit-on,
« donc il faut qu’ils calculent beaucoup… ». Ce qui, nous l’avons vu au n° 2, n’est
pas une implication à accepter sans nuances.
Ensuite, dit-on encore, les copies d’examens portant sur des calculs se notent plus
objectivement que celles qui portent sur des questions de réflexion. Devant un calcul,
on ne discute pas : on décompte autant par faute, selon un barème convenu. La
société scolaire attend du professeur de mathématique un jugement clair et net sur la « valeur » des élèves, ce qui semble plus difficile à obtenir des professeurs d’autres
matières. L’ennui, c’est que cette valeur est jugée sur un critère pour le moins
insuffisant. Quand on organise des examens de cette sorte, on refuse au nom de
l’objectivité de la note de vérifier si le cours de mathématiques a atteint ses objectifs
principaux, qui sont de l’ordre d’apprendre à penser plus que d’apprendre à calculer.
Enfin, il arrive aussi que le calcul soit enseigné par des routines du simple fait
qu’un tel enseignement, de toutes façons réputé important, est plus facile que
d’autres. Il évite d’avoir à penser, et l’enseignant n’y court aucun risque. Il serait
aussi faux d’éliminer a priori cette dernière hypothèse que de la généraliser.
4. Rôle et portée du calcul
Si le calcul routinier est la cause de si grandes et si anciennes difficultés, il est
opportun d’y réfléchir fondamentalement. Revenons sur notre question de départ.
Qu’est-ce que le calcul ? À quoi sert-il ? D’où vient-il ?
Calculer, c’est remplacer des pas de raisonnement par des manipulations
formelles (de symboles), c’est-à-dire sans s’inquiéter du sens, du fond. Il est possible
de calculer à l’intérieur de toute structure mathématique, en faisant fonctionner les
relations exprimées par les axiomes et les théorèmes.
La réduction du raisonnement, c’est-à-dire de la résolution des problèmes, au
calcul, revient comme un leitmotiv et un objectif fondamental à travers l’histoire des
mathématiques.
On le trouve chez Euclide lorsqu’il établit, dans les Éléments, les
bases d’un calcul sur les segments. Il revient chez Viète, qui, au XVIème siècle,
introduit l’usage des symboles en algèbre, pour la résolution des équations. Au
XVIIème siècle, Descartes et Fermat ramènent une bonne partie de la géométrie à des
calculs dans un système de coordonnées. Plus tard, dans le même siècle, Leibniz
tente de jeter les bases d’un calcul logique, qui sera plus tard repris par Boole. Sur
un autre plan, et en parallèle avec Newton, il ramène les recherches d’aires, de
volumes et de centres d’inertie à des calculs de primitives, alors qu’Archimède, vingt
siècles auparavant, inventait pour chaque problème de ce genre une méthode
appropriée.
À la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème, Lagrange s’efforce
de donner un fondement au calcul infinitésimal et à la mécanique en les réduisant à
de purs calculs. Au XVIIIème siècle, les déterminants sont introduits par
Vandermonde et Bézout pour synthétiser et rendre routinière la résolution des
équations linéaires. Les matrices apparaissent au XIXème siècle avec Cayley pour
calculer les transformations linéaires.
Faute d’espace, nous nous bornerons ici à ces
quelques jalons historiques. Mais sans doute suffisent-ils à témoigner de la constance
et de l’ingéniosité que les mathématiciens ont déployées pour remplacer, dès que
c’est possible, les raisonnements par des calculs. Serait-ce, puisqu’il est plus facile
de calculer que de penser, un effet de l’irrépressible paresse des hommes ?
Nous
verrons ci-après qu’il n’en est rien.
Mais voyons maintenant l’autre face de la question. S’il est vrai qu’il est plus
facile de calculer que de penser, il est par contre plus stimulant et plus éclairant de penser que de calculer. Sauf exception, calculer est ennuyeux.
Aussi des trésors
d’ingéniosité ont-ils été dépensés à travers l’histoire, d’une part pour abréger les
calculs, et d’autre part pour les remplacer quand c’est possible par « des
raisonnements conceptuels » (l’expression est de J. Dieudonné). Un exemple majeur
de cette tendance est le double courant d’idées qui a conduit à l’algèbre linéaire. Les
vecteurs ont servi non seulement à abréger les calculs en coordonnées de la
géométrie analytique (trois équations étant remplacées par une seule), mais encore à
se passer d’un système d’axes arbitraires et à calculer sur des éléments géométriques
appartenant aux figures étudiées, des éléments dits intrinsèques, et donc de conserver
au cours des calculs une vue de la question posée.
Les vecteurs ont engendré
historiquement les espaces vectoriels, et les transformations linéaires de ceux-ci ont
été d’abord étudiées en utilisant les matrices et les déterminants, dont nous avons vu
ci-dessus comment et pourquoi ils sont nés.
Mais déterminants et matrices sont des
outils lourds à manier et absorbants. Ils sont aujourd’hui remplacés dans la
construction théorique de l’algèbre linéaire par des raisonnements et calculs souvent
brefs, portant directement sur les transformations linéaires, et au cours desquels on
garde une vue claire de ce qu’on cherche. Il ne faudrait pas croire pourtant que les
coordonnées et les matrices ont été liquidées une fois pour toutes, car on est bien
obligé d’y revenir dès que l’on veut traiter numériquement un cas d’espèce.
Ainsi le calcul est un objet de contradiction : tantôt recherché et défendu avec
passion, tantôt rejeté et méprisé. Comment un seul et même type d’activité peut-il
inspirer des jugements et des sentiments aussi opposés ? La réponse n’est pas
compliquée : c’est que le calcul n’est rien par lui même, et que ce qui compte c’est
ce qu’il permet de faire, à savoir répondre à des questions, résoudre des problèmes.
Le calcul est en soi toujours inintéressant. Mais il arrive que ses résultats soient
intéressants, significatifs. Là est son unique enjeu.
Tout calcul sensé vient d’un
problème et y retourne. Accepter de perdre momentanément le sens de vue pour
s’enfoncer dans une suite d’opérations mécaniques comporte une frustration dont
l’intensité croît avec la longueur du calcul. Cette frustration n’est acceptée que
lorsque le résultat en vaut la peine.
Ainsi, la faveur qu’a le calcul à certains moments de l’histoire n’a rien à voir avec
la paresse des hommes, et des mathématiciens en particulier : ceux-ci aiment toujours
mieux penser que calculer, mais ils calculent volontiers, et parfois avec passion,
lorsque c’est pour eux le seul moyen de continuer à penser.
5. La parabole des myopes
Pourquoi en irait-il autrement de nos élèves ? Pourquoi supporteraient-ils plus
facilement que les mathématiciens de calculer pour calculer, c’est-à-dire de calculer
pour rien, de calculer pour obtenir un résultat qui ne soit la réponse à aucune
question ? D’ailleurs, ils demandent souvent « À quoi ça sert ? », et la réponse
habituelle « Tu verras plus tard » ne les satisfait pas.
Comme l’a écrit un jour Bourbaki, faire des mathématiques, c’est comme se
mouvoir dans un paysage. On veut aller quelque part, vers un but qu’on aperçoit dans
son horizon. On regarde à moyenne puis à courte distance comment on pourrait y
aller, quels sentiers permettraient de se rapprocher du but. Puis on avance dans un
sentier choisi, en surveillant chacun de ses pas. Après un moment, on relève la tête
pour voir le chemin qu’on a déjà fait et envisager la suite du parcours, etc., etc.
L’élève qui ne comprend pas pourquoi il calcule est comme un myope profond
(cf. N. Rouche [3]) soudain transporté dans un paysage mathématique. Il ne voit pas
plus loin que ses souliers et n’a le projet d’aller nulle part. On lui demande d’avancer
après lui avoir expliqué comment poser les pieds selon les règles. Quoi d’étonnant à
ce que, souvent, il refuse d’avancer, et s’il avance, trébuche ? Quoi d’étonnant aussi
à ce que, s’il y arrive, il ne retienne pas longtemps (comme nous l’avons noté au n° 2)
les façons de mettre les pieds, ou autrement dit les règles de calcul ?
Pour retenir une
chose, chacun de nous a le plus souvent besoin de la « raccrocher » à une autre ou à
d’autres. C’est une des leçons, simple mais toujours vivante, de la psychologie
associationniste du début du siècle. Les images et les idées s’associent de diverses
façons dans l’esprit et se retiennent du fait même de leurs associations. Nous avons
besoin d’un contexte qui nous amène à dire devant une situation nouvelle : « Ah mais
oui, je me souviens, c’est comme dans telle ou telle autre circonstance ! »
On
comprend dès lors que lorsqu’il n’y a pas de circonstances, lorsqu’on s’entraîne au
calcul pur et nu, le souvenir ne trouve rien à quoi s’accrocher. C’est un peu comme
d’essayer de mémoriser une page de l’annuaire téléphonique d’une localité inconnue.
Il manque des référents, il manque du sens. Le signifiant a perdu le signifié.
Devant cette situation, que faire pratiquement ? Deux choses dont l’une regarde
principalement les autorités qui conçoivent les programmes, et l’autre principalement
les enseignants dans leur pratique journalière.
6. Ne pas formaliser prématurément
La première est qu’il faudrait éviter, dans l’éducation mathématique, de
formaliser prématurément, c’est-à-dire d’introduire des structures, des relations, des
symboles et des algorithmes qui ne renvoient pas à un paysage mathématique
suffisamment riche et familier aux élèves. Car alors la structure avec sa combinatoire
de symboles risque trop de fonctionner à vide. L’expérience a prouvé largement et
tragiquement que ce danger est immense.
Ainsi par exemple lorsqu’on soumet des enfants au drill sur les opérations de
l’arithmétique avant qu’ils aient eu le temps de penser et d’expérimenter
suffisamment les nombres naturels et la numération, de se poser à leur propos assez
de questions significatives.
Randall Souviney, qui est un des responsables des problèmes d’éducation
mathématique à l’Université de Californie à San Diego, s’efforce – ce sont ses
propres dires – de formaliser l’arithmétique à l’école primaire le plus tard possible,
c’est-à-dire de maintenir les élèves le plus longtemps possible sur le terrain du sens, par opposition à celui des automatismes aveugles. Certes, il est bien évident que les
les élèves doivent apprendre à terme à pratiquer sans réfléchir les quatre opérations
sur des nombres pas trop grands (pour les autres, il y a dorénavant la calculatrice),
car où irions-nous s’il fallait tout prouver à chaque fois ? Mais pourquoi vouloir
presser cet apprentissage au point d’enfermer les élèves dans les automatismes, à
défaut de leur avoir donné préalablement les moyens de penser pour en sortir quand
c’est nécessaire ?
Autre exemple, parmi tant d’autres. Les règles de calcul sur les entiers positifs et
négatifs sont enseignées partiellement en primaire et complètement en première
année du secondaire, y compris la règle des signes pour le produit.
À cet âge, on
dispose d’un contexte raisonnable pour la somme : par exemple le calcul d’un bilan
de recettes et de dépenses, ou celui de la température moyenne en un lieu
donné pendant un mois d’hiver.
Par contre, dans beaucoup de classes, la règle des
signes fonctionne de façon purement formelle. Il arrive qu’elle soit présentée comme
une convention arbitraire, ou soutenue par des métaphores sans autre valeur que
mnémotechnique (deux négations font une affirmation, etc.). Il est vrai qu’il faut des
trésors d’ingéniosité pour la mettre à cet âge dans un contexte significatif, et que
l’une des circonstances principales où elle prend sens, à savoir la composition des
homothéties, n’intervient dans le programme que deux ans plus tard.
Voici un dernier exemple. On sait que les éléments de l’analyse mathématique,
les concepts de limite, dérivée et intégrale, sont difficiles. Or on voit souvent des
élèves s’entraîner en série au calcul automatique des dérivées et des intégrales avant
d’avoir suffisamment réfléchi à ces notions dans des contextes appropriés, touchant
aux tangentes, à l’application linéaire tangente, aux aires et aux volumes, aux
barycentres, aux valeurs moyennes, aux débits, aux vitesses, aux espaces
parcourus, …
Ainsi, dans l’éducation mathématique, le danger est constant de tomber dans la
pratique des règles avant d’avoir assuré le sens. S’il est vrai que toute théorie répond
à des questions, ne nous arrive-t-i1 pas trop souvent d’enseigner les réponses (c’est-à-
dire les théories) avant les questions, avant que les élèves aient suffisamment
éprouvé la nécessité de la théorie ?
Pour étayer ce propos, je voudrais citer Wu-Yi Hsiang, professeur de mathématiques
à l’Université de Berkeley et responsable d’une réforme de l’enseignement
secondaire mathématique en Chine populaire ; réforme ambitieuse, comme en témoigne
son titre : « Le Curriculum mathématique pour le XXIème siècle en République
Populaire de Chine ». Un principe de base de cette réforme est : ne jamais formaliser
tant que le besoin de le faire n’est pas arrivé. Le formalisme doit être approprié aux
problèmes que se pose la classe.
Y a-t-i1 moyen de concevoir un programme dans lequel les questions viennent
avant les réponses, c’est-à-dire où chaque théorie introduite réponde à un besoin (et
qu’on ne s’y méprenne pas : pas nécessairement un besoin pratique) ?
7. Une priorité absolue : la mise en calcul
Venons-en maintenant à ce que peuvent faire les enseignants dans leur pratique
journalière. Puisque tout calcul qui a du sens vient de quelque part et y retourne, ne
faut-il pas se soucier sans cesse de ce quelque part ? Si les élèves – c’est un fait
reconnu – sont en général si peu capables de savoir en quelles circonstances il faut
mobiliser tel ou tel moyen de calcul, n’est-ce pas parce qu’on leur a enseigné avant
tout le calcul, et très peu la mise en calcul, si on peut ainsi s’exprimer. Ne faudrait-il
pas que la mise en calcul devienne dans la classe de mathématique (et dans les
programmes), autant sinon plus importante que l’exécution du calcul ?
La mise en calcul peut porter sur des situations familières ou physiques, ou sur
des situations déjà mathématisées.
[Dans le premier cas, il s’agit de modéliser. À titre d’exemple, Nicolas Rouche,
à propos de l’eau s’écoulant d’un robinet cylindrique, relie patiemment le rayon du
jet à la distance de l’embouchure du robinet.]
Venons-en maintenant à quelques exemples de mise en calcul de situations
appartenant dès le départ au champ des mathématiques. Voici quelques variations
autour d’un thème connu.
[Nicolas Rouche développe alors l’étude de quatre problèmes :
Problème 1. Dessiner un rectangle de périmètre p et d’aire a (p et a donnés).
N. Rouche y voit un problème « qui vient de quelque part, …, qui va quelque
part, et donc exige une interprétation ». À comparer, dit-il, « avec le problème nu :
Étudiez, selon les règles apprises, l’équation $x^{2} + a x + b = 0$, … ».
Problème 2. 1. Dessinez le graphe de la fonction qui donne l’aire du carré en
fonction de son périmètre.
2. Même question pour les rectangles.
Problème 3. Déposez la table de multiplication sur une table de frigolite
horizontale. Au milieu de chaque case de la table, plantez un bâtonnet vertical dont
la hauteur soit proportionnelle au résultat indiqué dans la case. Décrivez la forêt de
bâtonnets ainsi obtenus. Que devient cette forêt quand on étend la table de
multiplication du côté des nombres négatifs ?
N. Rouche y montre l’introduction naturelle de paraboles et d’hyperboles, des
notions de surface réglée, de col et de selle… De belles maquettes des résultats
mathématiques y ressemblent à des oeuvres d’art fort séduisantes…
Problème 4. Quel est le lieu des points équidistants de deux droites gauches
orthogonales ?
… où l’on aboutit à un (familier ?) z = −xy.
N. Rouche conclut son texte de Mathématique et Pédagogie par un § 8 dont
voici quelques extraits :
8. L’analphabétisme mathématique
Tentons de conclure. Si on n’apprend que peu ou pas de mathématiques dans les
entraînements aux calculs aveugles, ceux qui ne viennent de nulle part et ne vont
nulle part, y apprend-on quand même quelque chose ? On y apprend en fait à obéir
aux injonctions arbitraires des détenteurs de la science cabalistique. On y développe
vis-à-vis des mystères de cette science une référence mystique et on apprend à la
craindre (l’adjectif mystique est de Wu-Yi Hsiang cité ci-dessus). On devient un
analphabète mathématique : il y en a partout dans la société.
Il y a donc un combat à mener chaque jour pour le sens. Tout le monde, et en
particulier tous les élèves ont droit au sens, à travailler dans un contexte qui ait du
sens.
[Après un vigoureux appel pour la création de « laboratoires de
mathématiques » dans tous les établissements, et de « banques de problèmes » de
tous niveaux, N. Rouche poursuit :]
P.S. Par la force des choses, le présent exposé laisse pas mal de points en suspens.
Je voudrais en mentionner deux pour terminer.
Comment concevoir les examens de mathématiques quand on a décidé de les
faire servir à vérifier les objectifs les plus profonds du cours et non plus la capacité
d’exécuter les calculs routiniers ? On trouvera une remarquable discussion de cette
question avec des propositions pratiques dans la thèse de J. de Lange [2].
Comment répondre à ceux, très nombreux, qui disent : on n’a pas le temps de
laisser chercher les élèves sur des questions significatives ? En première
approximation et en peu de mots : autant dire que l’on n’a pas le temps de leur
apprendre les mathématiques ? Alors qu’on trouve tant de temps à perdre dans un
apprentissage inefficace du calcul…
Bibliographie
[1] A. BELL, What does research say about teaching methods in mathematics ? Shell
Center for Mathematical Education, 1980 ; 26 p.
[2] J. de LANGE, Mathematics, insight and meaning, OW and OC, Utrecht, 1987.
[3] N. ROUCHE, Pourquoi les maths ?, Bulletin de l’A.P.M.E.P. 362 (1988) 1-24.