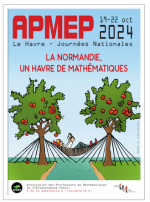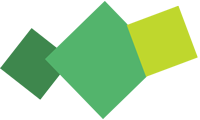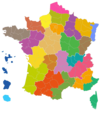476
Quelques exemples d’organisation dans d’autres pays
Le titre de cet exposé devrait plutôt être « Comment font-ils ailleurs ? ». Je ne vais pas en effet décrire des structures, mais seulement tenter de montrer comment d’autres pays gèrent un certain nombre de conflits inhérents à tout système d’éducation.
Je me limiterai aux nations qui dominent le monde scientifique et technique. J’insisterai particulièrement sur les États-Unis, pour deux raisons : d’une part, le modèle américain gagne du terrain dans le monde entier, d’autre part l’extrême décentralisation de cette mosaïque de cinquante États en fait un incroyable laboratoire où tout, le meilleur comme le pire, a été essayé.
Culture « générale » contre liberté de l’élève
L’élève qui désire devenir chercheur, ingénieur ou médecin doit dans nos lycées passer l’essentiel de son temps sur des disciplines étrangères à son projet personnel.
Dans ce qui est moins un programme de culture générale qu’un programme encyclopédique, sa liberté de choix se limite à deux heures hebdomadaires.
Cette situation, un petit nombre de séries à l’intérieur desquelles l’élève a toute l’autonomie d’un wagon sur des rails, ne se retrouve guère, parmi les grands pays développés, qu’en Italie (où la mise est dans une certaine mesure sauvée par les lycées expérimentaux) et à un moindre degré en Espagne.
Les USA et le Japon ont un régime de liberté surveillée : le fameux système des crédits. Pour obtenir son « bac », l’élève doit avoir acquis un certain nombre de crédits : un minimum global est imposé, ainsi qu’un minimum dans les disciplines de base. Les règles sont imposées par le ministère au Japon et par l’État et le district aux USA, le lycée pouvant les renforcer, non les affaiblir. Dans l’un et l’autre pays, le lycéen peut se limiter, une fois acquis les minima exigés, aux matières correspondant à ses projets d’avenir.
En Allemagne, pour les principales matières, deux niveaux sont proposés (niveau de base, niveau avancé) ; l’étudiant sera évalué sur quatre ou cinq matières, dont deux au niveau avancé ; dans le lot sont imposés l’allemand, une matière scientifique au moins, une matière de sciences humaines au moins.
Quant au Royaume Uni, c’est la liberté totale : le lycéen choisit, lors des deux dernières années de secondaire, les trois matières, parfois quatre, exceptionnellement cinq, qu’il étudiera et dans chacune desquelles il passera un examen.
Égalitarisme contre élitisme
Le syllogisme de nos énarques est connu : tous les maux viennent de l’élitisme, or la série C était élitiste, donc il fallait l’abattre ; tous les maux viennent de l’élitisme, or la série S est élitiste, donc, etc. Cette lutte contre l’élitisme, qui amène au terme du cursus à privilégier le carnet d’adresses du papa, me semble une spécificité française.
L’élitisme peut être envisagé de différents points de vue : inégalités entre lycées, existence au sein d’un même lycée de formations destinées aux meilleurs, donc aussi compétition entre lycées et compétition entre élèves. Selon les pays, l’attitude dans ces domaines est très différente, tout comme la pression mise sur les élèves.
Le système allemand, sélection précoce à 10 ou 11 ans, puis paisible ronron jusqu’à 19 ans dans le cadre du Gymnasium n’est pas follement stimulant, sauf pour le lycéen qui veut faire médecine ou pharmacie et devra absolument avoir une bonne moyenne à l’Abitur. En revanche, les élèves des Realschulen, qui terminent à 16 ans, doivent souquer ferme pour accéder à l’enseignement technologique secondaire long, puis supérieur.
Au Japon, si le collège unique est la règle, la compétition entre lycées est féroce : on entre dans les bons lycées sur concours. À l’intérieur du lycée, les élèves ambitieux travaillent dur pour préparer les difficiles concours d’entrée dans les universités. Ils passent régulièrement pour évaluer leurs chances des tests standardisés, qui déterminent leur hensachi, la note sur 100 qui les situe par rapport à la moyenne nationale. La rançon est élevée : règne des juku, les cours du soir privés, absence de lectures non scolaires autres que les mangas.
Le cas anglais est instructif. L’élitisme a été longtemps combattu par les travaillistes. Les fameuses grammar schools, écoles publiques réservées aux meilleurs élèves, ont été leur cible favorite au point qu’en 1965, le ministre de l’éducation Anthony Crosland déclara qu’il allait « destroy every fucking grammar school ». Le résultat de cette politique n’a pas été à la hauteur des attentes et, en 1996, Tony Blair décida de laisser survivre celles qui restaient (4% du flux des élèves). En outre, depuis 2002, le gouvernement encourage la mise en place des Advanced Extension Awards, sorte de superbacs visant explicitement les 10% meilleurs, ceux capables de « think more widely and critically », avec l’idée très nette de préparer l’entrée dans les meilleures universités.
Plus intéressant encore est ce qui se passe aux USA, car leur politique prend l’exact contre-pied de la nôtre. L’élitisme y est considéré comme une arme pour le progrès de tous et notamment des enfants des minorités défavorisées. Des programmes nationaux de certification des établissements ont été créés, le Blue Ribbon en 1982 et No Child Left Behind en 2001.
Dans chaque lycée, les principales matières sont proposées à deux niveaux au moins. Les plus ambitieux des cours de niveau élevé, les fameux Advanced Placements, présents maintenant dans tous les lycées de plus de 1200 élèves, reviendraient chez nous à créer en première et terminale des cours anticipant sur math sup ou hypokhâgne. Ils ont beaucoup fait pour l’amélioration de l’enseignement, notamment de l’enseignement scientifique.
Et ça marche : selon le Digest of Education Statistics, édition 2007, le point bas pour les effectifs d’étudiants scientifiques a été atteint en 2000. Depuis, les effectifs ont recommencé à augmenter de façon significative.
Formations supérieures ouvertes contre formations sélectives
On attribue souvent les maux de l’enseignement supérieur français soit à la dualité université-prépas, soit au fait que notre diplôme de fin d’études secondaires est un ticket d’accès à l’enseignement supérieur dans n’importe quelle spécialité, deux phénomènes considérés comme spécifiques de notre pays. En fait la situation n’est pas si différente ailleurs.
Dans la plupart des pays, le « bac », bien que plus libéralement accordé que chez nous (95% de succès ou plus) permet le plus souvent, d’accéder à certaines formations supérieures : enseignement pratique des community colleges ou des two-year-colleges aux USA, universités de deux ans au Japon (ce sont surtout d’aimables parkings pour filles à marier), universités de faible renom et/ou spécialités peu courues en Angleterre ou en Espagne, spécialités autres que biomédicales en Allemagne. Il n’y a qu’en Italie que l’université soit un gigantesque supermarché où entre qui veut.
En revanche, l’accès des grandes filières est le plus souvent hautement sélectif :
1 admis pour 10 candidats à Princeton, 1 pour 8 au MIT, 1 pour 3 ou 4 à Oxford ou Cambridge, alors que ne s’y présentent que des élèves triés sur le volet. Ajoutons que leurs anciens élèves valent largement, pour ce qui est du complexe de supériorité, nos énarques, normaliens ou autres polytechniciens.
La différence majeure entre ces universités d’élite et notre système de prépas et de grandes écoles est dans la dispersion et la spécialisation qui règnent chez nous : les promotions dépassent 3000 à Oxford et Cambridge, tout comme à Todai, la plus fameuse université japonaise. Elles sont de 1800 à Princeton, de 1500 au MIT (mais de 700 à peine à Caltech), alors que rares sont chez nous les écoles dont les promotions dépassent 300.
Une parenthèse pour en finir avec l’exemple américain. Peut-on donner en exemple aux princes qui nous gouvernent, si vraiment ils s’inquiètent du manque d’étudiants en sciences, le « Higher Education Reconciliation Act » de février 2006, par lequel le président Bush accorde des bourses, les Smart Grants, à de bons étudiants désirant poursuivre une carrière « in mathematics and science » ?
Mathématiques contre sciences expérimentales
On oppose systématiquement chez nous, depuis un bon quart de siècle, les mathématiques et les sciences expérimentales. Les premières se retrouvent régulièrement en position d’accusées et, à chaque réforme, on rogne leur part au profit de la biologie. Mais qu’en est-il ailleurs ?
L’existence de ce conflit français surprend beaucoup nos interlocuteurs. Un Américain m’a expliqué que c’était comme opposer langue et littérature, alors que la première est l’outil indispensable de la seconde.
Dans les pays dont j’ai parlé, le problème se pose dans des termes fort différents des nôtres. Chez nous, le pouvoir central répartit d’office entre des disciplines concurrentes la portion congrue assignée aux sciences. Chez eux, il s’agit d’une décision de l’élève : il prend une dose forte ou faible (voire nulle) de mathématiques, accompagnée d’une dose forte ou faible (voire nulle) d’une ou deux sciences expérimentales (jamais plus de deux). D’un côté, donc, un oukase, de l’autre un choix personnel.
Il n’est pas cependant sans intérêt de voir comment, dans leur ensemble, s’orientent ces choix individuels.
Si, au lycée japonais, les mathématiques dominent sans conteste, on pourrait s’attendre, dans la pragmatique société américaine, à une situation fort différente.
C’est d’ailleurs le cas dans l’enseignement supérieur : il sort chaque année quelque 200 000 bachelors en sciences expérimentales et appliquées, contre 15 000 en mathématiques. Mais, dans le secondaire, ce sont bel et bien les mathématiques qui priment. Grosso modo, leur poids, en nombre de credits par bachelier, est équivalent au poids total des sciences expérimentales. Même chose, ou peu s’en faut, pour les formations d’élite que sont les AP.
En Angleterre, la situation est moins nette, mais, en 2007, 59 000 candidats ont obtenu le A-level Maths. C’est un nombre très voisin du nombre annuel de bacheliers C avant la « rénovation » des lycées, mais il s’agit là d’étudiants pour lesquels les mathématiques représentent le tiers de leur temps d’études. Ajoutons que parmi eux, près de 8 000 ont passé en outre Further Maths, ce qui veut dire qu’ils ont consacré pendant deux ans les deux tiers de leur temps à faire des mathématiques.
La série C, donc, n’avait rien de tellement singulier. Ce qui l’est, en revanche, c’est qu’une série plébiscitée par les meilleurs élèves ait pu être éradiquée précisément pour cela. Pour un interlocuteur anglo-saxon, cela touche à l’impensable, pour ne pas dire l’absurde.
Pour conclure, je voudrais faire un retour en arrière : ce n’est pas la première fois que la France s’en prend à la formation scientifique et notamment mathématique de ses lycées. Bien avant notre rénovation des lycées et les projets qui sont agités en ce moment, il y avait eu la réforme Bérard de 1923 et son « égalité scientifique ».
Elle n’a, Dieu merci, vécu que deux ans. Mais à cette même date de 1923, l’Italie lançait la réforme Gentile, inspirée d’un esprit voisin. Cette réforme a eu, elle, un plein succès : près d’un siècle plus tard, les études scientifiques italiennes ne s’en sont pas encore vraiment relevées. Est-ce là, vraiment, l’avenir que l’on veut nous préparer ?
<redacteur|auteur=500>