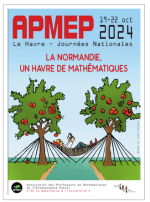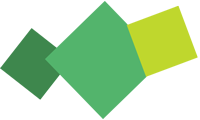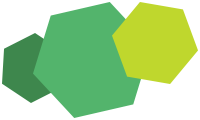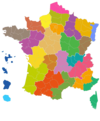462
Pour des fonctions qui fonctionnent.
Louis-Marie Bonneval [1]
L’enseignement des mathématiques est en crise. La pénurie d’étudiants scientifiques
est un symptôme du malaise qui touche l’ensemble des niveaux d’enseignement. Les
observateurs pointent notamment l’absence de sens de cet enseignement pour la
majorité des élèves. Citons Yves Chevallard [2] : L’enseignement actuel ressemble le
plus souvent à une visite guidée de monuments mathématiques autrefois vivants mais
dont les raisons d’être, les fonctions vitales ont cessé d’être comprises et reconnues.
Ou Claude Thélot [3] : Dire que les mathématiques aident à organiser sa pensée ne
suffit pas à leur donner du sens pour l’élève.
Une des causes de cette crise de sens est externe au système éducatif : elle est liée au
fantastique développement de l’informatique. Comme le remarque Gérard Kuntz [1],
les mathématiques, omniprésentes dans notre société technique, sont en général
cachées. Cachées où ? Principalement dans les logiciels qui pilotent la plupart des
objets industriels qui nous entourent. Dès lors, en apparence, à part pour les
scientifiques qui conçoivent ces objets, plus besoin de mathématiques ! La caissière
de supermarché n’a plus à faire d’additions ou de soustractions, la machine lui
indique la somme qu’elle doit rendre ! En inventant l’informatique, les
mathématiciens ont en quelque sorte scié la branche sur laquelle ils étaient installés !
Cette constatation ne nous dispense pas de réfléchir aux causes internes à notre
enseignement. La massification de l’accès au lycée, qui est un incontestable progrès,
pose de façon aiguë la question de la diversification des contenus et des méthodes
pédagogiques. On ne peut pas extrapoler à 70 % d’une classe d’âge ce qui était
destiné à 10 %. En mathématiques comme ailleurs, nous sommes conduits à revoir
les schémas qui prévalaient il y a cinquante ans.
Or, de façon dialectique, l’informatique, source de difficultés pour notre
enseignement, fournit aussi des outils qui, bien utilisés, peuvent devenir un levier
puissant pour les résoudre, en redonnant du sens aux mathématiques.
Quelles mathématiques au lycée pour les non-scientifiques ?
Diversifier l’enseignement des mathématiques suppose de distinguer, sans
opposition ni hiérarchisation, les élèves scientifiques des non-scientifiques.
Convenons d’appeler non-scientifiques les élèves qui n’étudieront plus les
mathématiques après le baccalauréat (sinon éventuellement les statistiques),
autrement dit la grande majorité des élèves de L, de ES, de STG, du lycée
professionnel. Les scientifiques quant à eux se trouvent dans les filières S, STI, STL,
ES option math. Bien sûr la frontière n’est pas nette : quid de la filière SMS, des
élèves de L option math, de la minorité de STG qui préparera une école de
commerce, voire des élèves de S qui s’orientent vers les Lettres ou le Droit ?
Pour les élèves scientifiques, l’absence de sens n’est pas ressentie comme un
obstacle : soit ils considèrent les mathématiques comme un jeu de l’esprit, dont ils
ont à peu près compris les règles, et alors ils réussissent dans l’institution scolaire, ce
qui est fortement valorisé socialement ; soit ils admettent plus ou moins confusément
qu’elles leur seront utiles plus tard, et ils acceptent de les subir si c’est le prix à payer
pour avoir un métier.
Mais les non-scientifiques ? L’intérêt des mathématiques leur échappe ; comme elles
sont pour eux source d’échec, ils les ressentent comme une brimade qu’on leur
impose arbitrairement.
Il est de bon ton chez certains collègues de mépriser la question « À quoi servent les
mathématiques ? », voire de répondre « à rien ! » à l’élève qui aurait l’impertinence
de la poser. Cette attitude m’a toujours choqué : même si l’intérêt d’une formation
n’est pas toujours facile à expliquer, et n’apparaît souvent que plus tard, il est
légitime qu’un élève s’interroge sur la finalité de ce qu’on lui impose. Ne pas
répondre, c’est aggraver son sentiment de brimade. D’autant que s’il pose la même
question à ses proches, il peut s’entendre dire : « Moi, en mathématiques j’étais nul,
et ça ne m’a pas du tout gêné, ni dans ma vie professionnelle ni dans ma vie
personnelle ! ». Et que les médias véhiculent souvent le même discours.
Il est vrai que la réponse n’est pas simple. Parler des sciences physiques n’est pas de
nature à convaincre les élèves non-scientifiques ! Mais plutôt qu’un discours, c’est
une évolution des pratiques d’enseignement qui peut « rétablir la confiance ». Cette
évolution se dessine depuis quelques années, marquée par une ouverture en direction
des autres disciplines et une réflexion sur la modélisation (cf. par exemple [5]).
Quelques ratés dans les sujets d’examen [4] ne doivent pas remettre en cause cette
tendance positive.
Il se trouve que j’ai fait partie entre novembre 2003 et juin 2005 du groupe de travail
chargé d’élaborer les programmes de première et terminale STG. En permanence
nous avons été confrontés à la question : « Qu’est-ce qui est possible et souhaitable
comme formation mathématique pour ces élèves, compte tenu de leurs difficultés
vis-à-vis de notre discipline ? ». Il nous a paru de bon sens de cibler prioritairement
sur l’information chiffrée, les statistiques et les probabilités. Mais je voudrais ici
parler de l’Analyse [5]. C’est en effet dans ce domaine que les choix du GEPS ont
suscité le plus de débats, alors qu’à mon sens, pour des raisons institutionnelles, nous
sommes restés au milieu du gué. Et la question déborde largement la seule série STG.
Pourquoi enseigner les fonctions ?
Au vu des difficultés des élèves en Analyse, on est obligé de se demander : pourquoi
enseigne-t-on les fonctions ?
Comme les autres notions mathématiques, les fonctions sont un outil pour résoudre
des problèmes.
Mais soyons clairs : les besoins concernent principalement les sciences « dures »
(physique, biologie, informatique, sciences de l’ingénieur, …). Pour les sciences
humaines, les besoins en Analyse au niveau du lycée sont très modestes. De plus, en
creusant la liaison mathématiques-économie, on est conduit à une certaine
circonspection [6].
Quoi qu’il en soit, la valeur formative de l’étude des fonctions dépasse leur aspect
immédiatement utilitaire, mais à la condition capitale que les élèves en comprennent
le sens : une fonction exprime la façon dont une grandeur dépend d’une autre.
Or il me semble que beaucoup d’élèves, même parmi les scientifiques, arrivent au
baccalauréat sans avoir vraiment compris cet aspect essentiel.
C’est en Seconde qu’est introduite la notion de fonction dans sa généralité.
Habituellement, on part d’une situation « concrète » (ou pseudo-concrète : peu
importe qu’elle soit artificielle) pour présenter plusieurs éclairages du concept de
fonction : tableau de nombres, courbe, formule. Mais ensuite, trop vite à mon avis,
on oublie les situations concrètes pour se focaliser sur des formules ou des courbes
données a priori.
Dans la pratique de l’enseignement des mathématiques au lycée, j’ai toujours été
frappé par la différence d’approche entre les domaines anciens (géométrie, analyse)
et les domaines plus récents (statistiques, probabilités, graphes) : les problèmes
concernant les seconds sont presque toujours contextualisés, alors que ceux qui
concernent les premiers le sont très rarement. Les commentaires des programmes
poussent d’ailleurs à cette différenciation : pour les statistiques ou les graphes, on
recommande de chercher des situations qui motivent les élèves ; rien de tel en ce qui
concerne les fonctions. Plus ou moins consciemment, le professeur de
mathématiques délègue ce rôle de contextualisation à son collègue de physique ou
d’économie. Or les habitudes de langage, de notation, de pratique sont différentes des
nôtres dans ces disciplines, si bien que les transferts se font mal.
Dès lors l’incompréhension subsiste et, pour beaucoup d’élèves, la fonction demeure
quelque chose d’étrange, au statut mal défini. Alors ils essaient de se sécuriser en
assimilant la fonction soit à une formule, soit à une courbe. Je crois qu’il ne faut pas
chercher ailleurs la cause des confusions omniprésentes dans les copies :
entre f et f (x) (une fonction, c’est une formule avec des x) : « \(\frac{1}{x}\) est
décroissante », « \(x^2\) est positive », … ;
entre f et \(C_f\) (une fonction c’est une courbe) : « la fonction coupe l’axe des x »,
« la parabole change de signe », « la courbe est croissante », « la droite est
linéaire », … ;
par conséquent entre \(C_f\) et f (x) : « \(x^3\) passe par O », « la droite 2x + 1 », « la
parabole \(x^2\) », …
Changer de cadre
On sait l’importance des changements de cadre pour la compréhension d’un concept
[7]. Avec les fonctions, on dispose de trois cadres : numérique-algébrique,
fonctionnel, géométrique-graphique. Confronter ces trois cadres ne signifie
nullement les confondre.
Par exemple, il me paraît formateur de travailler sur l’équivalence des formulations
suivantes (où P désigne la parabole représentant la fonction « carré ») :
Cadre numérique-algébrique : « Un carré est toujours positif ».
Cadre fonctionnel : « La fonction « carré » est positive sur \(\mathbb{R}\) ».
Cadre géométrique-graphique : « P est tout entière au-dessus de l’axe des
abscisses ».
Il est bon à cette occasion de demander : pourquoi on n’écrit pas « la fonction
carrée » mais « la fonction “ carré ” » (faudrait-il dire « la fonction “ carré de ” » ?) ;
comment le mot « toujours » de la première phrase est traduit dans les deux autres
phrases ; pourquoi des phrases comme « \(x^2 \) est positive sur \(\mathbb{R}\) » ou « la parabole est
positive » ou « la fonction “ carré ” est au-dessus de l’axe des abscisses » n’ont pas
de sens…
De même, les trois questions ci-dessous sont équivalentes, mais selon mon
expérience la deuxième aura un taux de réussite plus faible que la troisième, qui elle-même
aura moins de succès que la première :
Cadre numérique-algébrique : « Résoudre l’équation f (x) = 0 ».
Cadre fonctionnel : « Chercher les antécédents de 0 par la fonction f ».
Cadre géométrique-graphique : « Chercher les abscisses des points d’intersection
de la courbe avec l’axe des abscisses ».
Le fait de donner un nom aux fonctions de référence (carré, inverse, cube, racine
carrée, valeur absolue) est une innovation relativement récente, qui fait parfois
sourire les mathématiciens chevronnés. C’est pourtant un progrès au plan didactique
parce que cela permet de bien distinguer fonction et image. D’autres fonctions
bénéficient d’ailleurs de ce privilège : cos, sin, tan, exp, ln, int. Je me demande même
si on ne pourrait pas aller plus loin, en introduisant les notations car, inv, cub, rac, abs
(les notations rac et abs sont d’ailleurs utilisées en informatique, et permettraient
peut-être de débloquer certains obstacles résistants concernant la racine carrée et la
valeur absolue).
De même, le fait de disposer d’un nom pour la courbe (parabole, hyperbole, cubique,
demi-parabole, V, …) permet de distinguer fonction et courbe. Toute médaille ayant
son revers, cela peut aussi engendrer des malentendus : certains élèves semblent
croire que toute parabole représente la fonction « carré », que toute hyperbole
représente la fonction « inverse » !
Les jeunes manquent de repères
Cette distinction entre fonction et courbe me paraît capitale, non seulement parce que
les deux notions n’ont a priori rien à voir, mais surtout parce que leur rapprochement
nécessite cet intermédiaire obligé qu’est le repère [6]. Or il y a beaucoup à faire pour
que le rôle du repère soit compris et maîtrisé. Un peu d’histoire des mathématiques
serait certainement éclairant pour les élèves : avant Descartes, personne n’avait eu
l’idée d’associer une courbe et une équation.
Je voudrais souligner quelques aspects qui méritent qu’on s’y attarde :
À toute fonction on peut associer une courbe, alors qu’à une courbe on ne peut pas
toujours associer une fonction : un cercle ne peut pas représenter une fonction ; toute
fonction affine est représentée par une droite, mais une droite ne représente une
fonction que si elle coupe l’axe des ordonnées ; toute fonction trinôme est
représentée par une parabole, mais une parabole ne représente une fonction que si
son axe est parallèle à l’axe des ordonnées. Banalités ? Posons donc la question à nos
élèves…
Il y a dans nos manuels d’Analyse une tendance abusive à choisir un repère
orthonormé [7]. Dans les sciences appliquées les repères sont toujours orthogonaux
(c’est nettement plus commode), mais très rarement orthonormés : les deux
grandeurs représentées (qu’il est d’ailleurs bon d’indiquer explicitement sur chaque
axe) n’étant pas en général de même nature, il n’y a aucun lien entre les deux unités.
Notons à ce propos que les tableurs choisissent automatiquement la fenêtre la mieux
adaptée, alors que pour la calculatrice c’est à l’utilisateur de faire ce choix : il y a là
une compétence à développer.
On sait les difficultés que posent les changements de repère. Il n’est pas question
en section non-scientifique d’aborder les changements de direction d’axes (sinon
l’échange des axes, qui peut être très instructif). Mais on peut travailler sur le
changement d’origine (qui pour une même fonction modifie l’emplacement de la
courbe) et sur les changements d’unités (qui pour une même fonction modifient la
forme de la courbe). Ces deux démarches sont à rapprocher du choix de la fenêtre
évoqué ci-dessus. Elles sont l’occasion d’observer qu’une même fonction est
représentée dans des repères différents par des courbes différentes, mais que ces
courbes ont les mêmes propriétés fondamentales (signe, sens de variation,
extremums, …). Ainsi, pour une fonction donnée, deux élèves voisins n’auront peut-être
pas la même courbe sur l’écran de leur calculatrice (ce qui étonne les débutants),
mais ils y liront les mêmes propriétés.
La ressemblance en français entre les deux mots expression et équation engendre
des confusions entre l’expression d’une fonction et l’équation d’une courbe.
Combien d’élèves parlent ainsi de « la droite 2x + 1 » ? Ou écrivent \(x^2\) à côté de la
parabole représentant la fonction « carré » (défaut qu’on retrouve malheureusement
dans certains logiciels et sur certaines calculatrices) ? Il est utile de travailler sur les
écritures équivalentes de l’équation d’une courbe [8] (d’une droite pour commencer)
pour souligner que c’est en isolant y (si on peut) qu’on met en évidence l’éventuelle
fonction représentée. Pourquoi d’ailleurs ne pas écrire de temps en temps f (x) = y ou
f (x) − y = 0, au lieu de y = f (x) ?
Les copies révèlent que beaucoup d’élèves interprètent l’égalité y = f (x) non pas
comme une équation mais comme une identité (il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire
sur l’habitude de sous-entendre les quantificateurs universels). Pour leur faire sentir que y n’est pas toujours égal à f (x), il peut être utile de demander où sont les points
tels que y < f (x) ou y > f (x). Les systèmes d’inéquations à deux inconnues sont
formateurs notamment parce qu’ils montrent que si une équation caractérise une
courbe du plan, une inéquation caractérise une zone du plan.
Les lettres x et y sont universellement choisies pour désigner respectivement
l’abscisse et l’ordonnée [9] : par conséquent si la fonction f étudiée exprime d en
fonction de t, l’équation de la courbe est bien y = f (x) et non pas d = f (t).
Et les grandeurs ?
Aux trois cadres cités plus haut, je voudrais ajouter un quatrième : les grandeurs [2].
Les mathématiciens du XX° siècle, notamment l’école Bourbaki, ont voulu évacuer
les grandeurs du champ des mathématiques. On se rend compte aujourd’hui qu’en
éloignant les mathématiques de la réalité physique, cela a créé des difficultés de
compréhension au niveau de l’enseignement. C’est pourquoi d’ailleurs les grandeurs
reprennent explicitement droit de cité à l’école et au collège.
Répétons-le : ce sont les grandeurs qui donnent du sens à la notion de fonction. Dans
certaines sciences appliquées, on désigne parfois par « grandeur explicative » et
« grandeur expliquée » ce que nous appelons « variable » et « image » : ce langage
peut être éclairant.
Considérons par exemple la fonction f qui exprime le résultat d’exploitation d’une
entreprise en fonction de la quantité produite. Son signe a une interprétation simple :
selon que f est positive ou négative, l’entreprise fait un bénéfice ou une perte. Son
sens de variation a aussi une interprétation simple : selon que f est croissante ou
décroissante, une augmentation de la production améliore ou détériore le résultat
d’exploitation.
Une compétence à mon avis essentielle est rarement testée : la capacité à nommer
une fonction qui n’est pas nommée dans l’énoncé. Prenons l’exemple classique de la
boîte : partant d’une feuille de carton rectangulaire de dimensions L et l données
numériquement, on replie sur les quatre bords une bande de largeur x ; on cherche
x pour que le volume de la boîte (ouverte) ainsi obtenue soit maximal.
Trouver la
formule \(V=x (L-2x)(l-2x) \) témoigne d’un savoir-faire important ; appeler f la
fonction qui à x associe V témoigne d’un autre savoir-faire, décisif pour résoudre le
problème, et montrant une bonne compréhension de la notion de fonction.
Développer ce savoir-faire est d’autant plus important qu’il est en général méconnu
dans les sciences appliquées. Dans l’exemple précédent, l’utilisateur peut dire « le
volume de la boîte est fonction de la largeur de la bande », mais n’éprouve pas
nécessairement le besoin d’écrire V = f (x). Ainsi, beaucoup d’élèves ne se rendent
pas compte que les fonctions sont omniprésentes dans les sciences appliquées, tout
simplement parce qu’ils ne les voient pas écrites ! De là à penser que ce qu’ils font
en mathématiques avec les fonctions ne sert à rien, il n’y a qu’un pas, que beaucoup
n’hésitent pas à franchir ! Une pratique courante consiste à écrire V = V(x) : certes c’est plus économique, puisqu’il n’y a pas besoin de la lettre f. Mais cela confond la
fonction et l’image, ce qui génère les incompréhensions décrites plus haut. Surtout,
cela cantonne la notation f au seul champ mathématique, bloquant ainsi le transfert
indispensable d’une discipline à l’autre. C’est pourquoi, plutôt que d’adopter
l’écriture V = V(x), il me paraît bien préférable que le professeur de mathématiques
explicite la fonction en écrivant V = f (x).
Observons aussi sur cet exemple que le choix de la lettre x pour désigner la largeur
de la bande est un coup de pouce pour faciliter la modélisation. Bien des élèves ont
beaucoup de mal à reconnaître une fonction quand la variable ne s’appelle pas x : il
est indispensable de les y entraîner, en choisissant de temps en temps d’autres lettres.
Si le travail sur les fonctions se fait à partir de problèmes, le nom de la variable
s’impose en général : comme en physique, on choisit une lettre évocatrice, souvent
l’initiale de la grandeur considérée.
Comprendre le sens de variation
Le sens de variation est incontestablement la notion la plus importante concernant les
fonctions. Or la plupart des élèves de Première non-scientifique ont beaucoup de mal
à comprendre de quoi il s’agit. Beaucoup confondent sens de variation et signe.
L’interprétation graphique est bien entendu fondamentale. Certains collègues
répugnent à dire « la courbe monte ». Cela présente pourtant l’avantage de permettre
une formulation dans le cadre graphique, distincte de la formulation dans le cadre
fonctionnel (« la fonction est croissante »), comme pour les autres propriétés des
fonctions : « la fonction est positive » se traduit par « la courbe est au-dessus de l’axe
des abscisses » ; « la fonction est impaire » se traduit par « la courbe admet l’origine
comme centre de symétrie » ; « la fonction est dérivable » se traduit par « la courbe
admet une tangente (non verticale) », etc.
Mais l’interprétation graphique ne dit pas en quoi cette notion est importante.
Beaucoup d’élèves étudient le sens de variation puisqu’on le leur impose, mais se
demandent pourquoi diable on se donne tout ce mal.
Avant de se doter d’outils performants pour étudier le sens de variation, il me semble
nécessaire de prendre le temps de mûrir cette notion, en travaillant sur le sens (!) plus
que sur la technique : une fonction croissante conserve l’ordre ; une fonction
décroissante renverse l’ordre. Autrement dit, le sens de variation indique si une
augmentation de la variable suscite une augmentation ou une diminution de l’image.
Bien sûr, cette compréhension de base devrait être acquise en fin de Seconde : chacun
sait que pour les élèves non-scientifiques, ce n’est pas le cas.
D’ailleurs, même pour les élèves scientifiques j’ai quelques doutes. Une réaction de
mes élèves de terminale S il y a quelques années me paraît révélatrice. Après avoir
introduit la fonction ln, j’avais proposé en évaluation un exercice sur la magnitude
d’une étoile, donnée en fonction de son éclat par la formule \(m = k ln(E/E_{0}) \) où k est
une constante négative. J’avais posé la question suivante, qui me semblait facile :
montrer que plus l’éclat est grand plus la magnitude est petite.
Or non seulement
cette question avait été très peu traitée, mais quand à la correction j’avais parlé de
fonction décroissante, j’avais déclenché une réaction de stupeur ! Non seulement mes élèves ne voyaient pas de décroissance, mais beaucoup d’entre eux ne voyaient pas
de fonction !
Il faut en Première multiplier les activités mettant en œuvre deux grandeurs : l’impôt
est fonction croissante du revenu ; la pression atmosphérique est fonction
décroissante de l’altitude ; le coût total de production est fonction croissante de la
quantité produite ; l’offre est fonction croissante du prix unitaire, la demande est
fonction décroissante du prix unitaire ; la taille d’un enfant est fonction croissante de
son âge … Demander aux élèves d’expliquer les phrases précédentes me paraît très
formateur.
Voici par exemple quelques énoncés :
1) On considère un tétraèdre régulier, on appelle x la longueur de son côté en cm, et
f (x) son volume en \(cm^3\). Quel est le sens de variation de la fonction f ?
Pour répondre on n’a pas besoin de formule : il est clair que si le côté augmente le
volume augmente. Si on en a le temps et le désir, on peut ensuite chercher la formule
(qui n’a rien d’immédiat), et prolonger l’étude de f dans les cadres algébrique,
fonctionnel, graphique. Mais il serait regrettable d’omettre cette première question.
2) On verse de l’eau dans un Erlenmeyer (verre conique). On note v le volume d’eau
(en \(cm^3\)), et f (v) la hauteur de l’eau (en cm). Quel est le sens de variation de f ?
Même commentaire : pas besoin de formule ni de courbe pour répondre.
2bis) On verse de l’eau dans un Erlenmeyer. On note h la hauteur de l’eau, et g(h)
le volume d’eau (en \(cm^3\)). Quel est le sens de variation de g ?
En comparant les questions 2 et 2bis, on comprend pourquoi deux fonctions
réciproques l’une de l’autre ont le même sens de variation. Si on poursuit l’étude par
la recherche des formules, la présentation au tableur sur deux colonnes pourra
grandement faciliter cette compréhension. Quant à l’étude graphique, elle montre
comment l’échange des deux axes (qui restent identifiés par la grandeur qu’ils
représentent) permet de passer d’une courbe à l’autre.
Dans les exemples ci-dessus, comme dans beaucoup de situations pratiques, la
variable comme l’image sont positives, et la fonction est monotone : il ne faut pas
négliger ces situations sous prétexte qu’elles sont trop simples. Le problème peut être
de résoudre une équation de la forme f (x) = k. Si l’on ne sait pas résoudre exactement
cette équation, on peut la traiter de façon approchée, au tableur ou à la calculatrice,
par observation graphique et balayage de plus en plus fin.
Mais, bien sûr, les problèmes d’optimisation, comme celui de la boîte évoqué plus
haut, sont les plus motivants. Rechercher un maximum ou un minimum par
observation de la courbe et/ou tabulation de la fonction permet de faire une
conjecture, et motive la recherche d’une démonstration si celle-ci est accessible.
Les difficultés de la dérivation
Venons-en à la dérivation. J’ai le sentiment que beaucoup de professeurs de
mathématiques, surentraînés à sa pratique, en sous-estiment la difficulté pour les
débutants. Or, pour des élèves peu à l’aise en mathématiques, les multiples obstacles
en obscurcissent complètement le sens.
1) La notion de nombre dérivé
Classiquement le nombre dérivé est défini comme limite d’un taux d’accroissement.
Or trente-cinq années d’enseignement en lycée m’ont convaincu qu’enseigner en
section non-scientifique la notion de limite d’une fonction est une mission
impossible. Quelle que soit la définition qu’on tente d’en donner, elle n’est pas
comprise au point de permettre des raisonnements. Dès lors le chapitre « limites » est
un fastidieux catalogue de recettes où l’élève doit tout apprendre sans comprendre :
belle formation à l’esprit scientifique ! Pour faire « passer la pilule », on lui conseille
de se fier à son intuition (ce qui n’est pas la consigne habituelle en mathématiques) :
hélas, bien souvent ce que lui souffle son intuition est faux !
Historiquement, le calcul différentiel a précédé d’un siècle et demi la formalisation
de la notion de limite. Cela suggère que la limite est une notion plus difficile, mais
aussi qu’on peut faire des choses intéressantes sans elle.
Si l’objectif est uniquement de définir le nombre dérivé, il est plus satisfaisant de
court-circuiter complètement la notion de limite, et de considérer la tangente comme
une notion première. Il y a bien d’autres notions fondamentales qu’on ne définit pas
dans le secondaire : le nombre, le point, la droite, la fonction, la probabilité, … Cela
n’empêche pas de les utiliser, et de raisonner. Le professeur peut d’ailleurs très bien
dire « la tangente est la position limite de la sécante », et le montrer sur une
animation, sans détailler davantage.
Quel que soit le mode d’introduction, il faut donner aux élèves le temps de
comprendre ce qu’est le nombre dérivé (d’autant que, pour beaucoup d’élèves de
Première non-scientifique, la notion de coefficient directeur n’est pas acquise). Des
activités bien conçues peuvent lui donner du sens (vitesse, coût marginal, petits taux
d’évolution, propension à consommer, …), mais cela suppose d’en prendre le temps.
2) La notion de fonction dérivée
Le passage du nombre dérivé à la fonction dérivée présente au moins deux obstacles,
que les élèves même scientifiques ont beaucoup de mal à franchir :
Le passage de f ’(a) à f ’(x) : le x qui était voisin de a dans la phase d’introduction du
nombre dérivé, change de statut et se substitue tout-à-coup au a. Le fait de poser
x = a + h ne résout pas vraiment cette difficulté : ce h provisoire dont on ne parlera
plus jamais reste incongru pour beaucoup d’élèves. Pour compliquer encore, la lettre
a évoque irrésistiblement à certains un coefficient directeur ! C’est pour contourner
ces difficultés que le programme de STG a proposé d’écrire \(f ’(x_A)\).
Le passage de f ’(x) à f ’ : les élèves cherchent une courbe (puisque, pour beaucoup
d’entre eux, une fonction, c’est une courbe) et ils ne la voient pas. Certains croient
que f ’ est représentée par la tangente !
Ce passage se fait trop vite. C’est pourquoi le programme de STG a voulu laisser un
temps de maturation entre l’introduction du nombre dérivé (en Première) et celle de
la fonction dérivée (en Terminale).
3) Les problèmes de langage
Je suis très surpris que des collègues, par ailleurs pointilleux voire intégristes quant
au langage, confondent couramment fonction et image, particulièrement quand il s’agit de dérivation. Dire « la dérivée de \(x^2\) est 2x » est un abus de langage, bénin si
l’interlocuteur est un collègue, catastrophique si c’est un élève de lycée :
• cela confond fonction et image, et à un moment de l’apprentissage où la notion de
fonction dérivée est encore obscure. Bien des élèves écrivent ainsi f (x)’, ce qui leur
fait faire des erreurs ; qui n’a lu dans les copies : f (2) = 1 donc f (2)’ = 0 ?br>
• cela contrevient à un principe universel en mathématiques : une lettre muette peut
être remplacée par n’importe quel nombre. De la phrase incriminée un élève serait en
droit de déduire que « la dérivée de 9 est 6 » !
Certes une formulation correcte est plus lourde : mais c’est à nous enseignants de
trouver comment dire les choses de façon simple et juste. Par exemple : « Pour la
fonction “ carré ”, le nombre dérivé en x est 2x ».
Un autre obstacle : l’habitude regrettable de parler de dérivée en un point. En
première non-scientifique, certains élèves confondent point et nombre, et ont du mal
à comprendre qu’un point du plan a deux coordonnées même s’il est situé sur l’un
des axes (certains élèves semblent même croire que le « point d’abscisse » est un
objet mathématique, de même que la « droite d’équation » !). Or dans les deux
expressions « tangente en un point », « nombre dérivé en un point », le mot point n’a
pas le même sens : dans la première il désigne un point du plan, dans la deuxième il
désigne un nombre, à savoir l’abscisse du précédent. On voudrait pousser l’élève à
l’erreur qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! [10]
4) Les difficultés techniques
Étudier le sens de variation d’une fonction à l’aide de la dérivée suppose au moins
trois compétences :
• Connaître les formules de dérivation (formules à apprendre sans comprendre, ce
qui n’est guère formateur).
• Les appliquer sans erreur (ce qui pose des difficultés aux élèves peu à l’aise en
calcul littéral).
• Étudier le signe de la dérivée (ce qui met en jeu à nouveau des savoir-faire
antérieurs mal maîtrisés).
Autant dire que la probabilité d’erreur est proche de 1 !
Devant tant d’obstacles, l’élève moyen perd le fil de ses calculs et oublie le sens de
ce qu’il fait.
Faut-il enseigner la dérivation ?
Au vu de ces difficultés, on peut se demander s’il est vraiment nécessaire en section
non-scientifique d’enseigner la dérivation.
L’argument principal en faveur de la dérivée est qu’elle fournit l’outil-clé pour
étudier le sens de variation d’une fonction.
Cet argument, auquel je souscris pour les élèves scientifiques, me paraît très
contestable pour les non-scientifiques. Il suppose en effet deux préalables, dont je
doute qu’ils soient réalisés pour la majorité des élèves :
que les élèves aient compris ce qu’est le sens de variation d’une fonction, qu’ils
le distinguent de son signe, et qu’ils voient l’intérêt de l’étudier. Sinon, à quoi bon
se doter d’une grosse artillerie pour cela ?
qu’ils soient plus performants dans le calcul d’une dérivée et l’étude de son signe
que dans l’étude directe d’un sens de variation. Pour beaucoup d’entre eux, les
difficultés techniques évoquées ci-dessus atténuent singulièrement l’efficacité de
l’outil.
De plus, l’usage de la dérivation suppose d’admettre beaucoup de choses : la notion
de limite, les formules de dérivation, le théorème associant au signe de la fonction
dérivée le sens de variation de la fonction primitive. Si ce dernier théorème peut être
expliqué graphiquement, ce n’est pas le cas pour la dérivation d’une somme, d’un
produit ou d’un quotient ! Or plus l’élève doit admettre sans comprendre, plus il se
construit une image dogmatique des mathématiques, contraire à nos objectifs de
formation.
Une approche alternative
Jusque dans les années 1970 on ne disposait pas d’autre outil pour étudier le sens de
variation d’une fonction que le signe de sa dérivée (et quelques outils algébriques que
j’évoque plus loin). Au terme d’une étude souvent laborieuse, la courbe apparaissait
comme la récompense des efforts consentis : c’est elle en effet qui résumait de façon
visuelle les propriétés de la fonction. On calculait les quelques images utiles, mais on
n’avait pas les moyens de tabuler complètement une fonction sur un intervalle. Les
professionnels qui en avaient besoin y consacraient un temps considérable, à grands
renfort de tables de logarithmes…
Cette problématique a été complètement renouvelée par l’informatique. Il est
aujourd’hui facile, avant toute étude, de tabuler une fonction (avec le pas qu’on veut)
et de la représenter graphiquement (dans la fenêtre qu’on veut). On dispose ainsi
d’outils puissants pour résoudre les problèmes.
Reprenons l’exemple de la boîte évoqué plus haut. Classiquement on dérive la
fonction f pour étudier ses variations, ce qui met en évidence le maximum. Mais une
tout autre démarche permet de résoudre le problème : au tableur ou à la calculatrice,
on tabule la fonction et on la représente, ce qui met également en évidence le
maximum. Certes on l’obtient de façon approchée, mais on peut affiner la précision
en changeant le pas de la table : cela satisfait l’utilisateur tout autant qu’une valeur
exacte, dont il s’empresserait de chercher une valeur approchée décimale !
À mon avis, l’utilisation du tableur et de la calculatrice pour étudier les fonctions
devrait à terme réserver la dérivation aux élèves scientifiques du lycée, pour qui, bien
sûr, le calcul différentiel (et intégral) est toujours indispensable, car c’est un outil
théorique incomparable. Je veux parler des élèves de S, de STI, de spécialité math en
ES et L (c’est le cas actuellement en L, mais pas en ES). Et pour les bacheliers STG,
STL, SMS qui en ont besoin, cela pourrait être abordé dans l’enseignement supérieur.
Des savoir-faire nouveaux
Dès lors, pour les non-scientifiques, le véritable enjeu de la formation se déplace. On
peut lister une première série de compétences :
sur calculatrice : savoir entrer une fonction, la tabuler, choisir une fenêtre adaptée
pour la représenter.
sur tableur : savoir entrer une formule, la recopier, construire un graphique.
Cela n’a rien d’immédiat et demande par conséquent un apprentissage. Cet
apprentissage, long, progressif, méthodique, est trop souvent négligé. Il faut dire
qu’il présente pour l’enseignant des difficultés concrètes : pour la calculatrice, la
diversité des modèles ; pour le tableur, la difficulté pour accéder régulièrement en
demi-classe à une salle d’informatique fiable. Il est néanmoins nécessaire : ceux qui
parlent de « presse-bouton » n’ont probablement pas beaucoup pratiqué ces outils !
Une deuxième série de compétences consiste à :
savoir interpréter les informations de la calculatrice ou du tableur : images,
antécédents, signe, sens de variation, extremums.
savoir passer du cadre graphique au cadre numérique et inversement (comparer
une table de valeurs et une courbe, placer des points, lire des images et des
antécédents, lire un sens de variation, repérer un extremum, …).
Ces outils permettent d’ailleurs de traiter des problèmes rarement abordés parce que
le calcul différentiel y est malaisé :
les fonctions dont la dérivée est difficile à calculer, ou de signe difficile à
déterminer. Par exemple les problèmes de trajet minimal, comme la réfraction de
la lumière : quel est le trajet d’un rayon lumineux qui traverse deux milieux
successifs, connaissant la vitesse de la lumière dans chaque milieu et sachant
qu’elle minimise la durée du parcours ? On est conduit à une fonction f de la
forme \( f(x) = \frac{\sqrt{x^{2}+a^{2}}}{v_1}
+\frac{\sqrt{(b-x)^{2}}+c^{2}}{v_2} \)
dont l’étude par la dérivation est assez
laborieuse.
les fonctions de deux variables. Elles sont évoquées en spécialité de Terminale ES
via les surfaces, en Terminale STG via la « programmation linéaire », où seules
sont envisagées des fonctions linéaires. Le tableur permet de traiter une fonction
de deux variables à peu près comme une fonction d’une variable, alors que par le
calcul différentiel on a besoin d’outils nouveaux.
Fait-on vraiment des mathématiques ?
Mais, dira-t-on peut-être, si on se contente d’observer, on ne fait pas de
mathématiques.
À cela on peut répondre à deux niveaux :
1) Savoir utiliser intelligemment les outils de calcul, c’est faire des mathématiques.
On sait le rôle essentiel qu’ont joué dans l’histoire des mathématiques les
instruments de calcul : règle et compas, abaques, bâton de Jacob, rapporteur,
astrolabe, sextant, tables de logarithmes, différentiateurs, intégrateurs, règle à
calcul, … Ces instruments, issus d’une réflexion théorique, ont permis d’engranger
des observations et de résoudre des problèmes ; ces avancées ont à leur tour suscité
de nouvelles réflexions, qui ont permis d’inventer de nouveaux instruments, etc.
L’ordinateur est une superbe illustration de la phase actuelle de ce processus : issu de
travaux théoriques difficiles, il offre à la réflexion un champ immense et sans cesse
renouvelé, par ses capacités fantastiques d’expérimentation et de vérification. Il
permet de faire des mathématiques expérimentales, ce que recommandent d’ailleurs
les programmes actuels. Il permet de résoudre des problèmes, ce qui est bien la
finalité des mathématiques.
Mais, redisons-le, son usage raisonné suppose un apprentissage : il n’a rien
d’immédiat, comme en témoigne la difficulté qu’ont à s’y mettre bon nombre de
collègues…
2) Mais en mathématiques les observations doivent être validées par le raisonnement.
En effet l’un des objectifs fondamentaux de notre enseignement est d’apprendre à
raisonner juste, ce qui suppose de soumettre à la critique l’impression première, de
façon à faire le tri entre les intuitions justes et les intuitions fausses.
Pour en rester au domaine de l’Analyse, on sait bien que, si ce qu’on voit à l’écran
(table ou courbe) permet des conjectures, cela ne suffit pas à démontrer les propriétés
de la fonction. Et ceci pour au moins trois raisons, qu’on peut résumer par trois mots :
approximation, interpolation, extrapolation.
• Approximation : les valeurs calculées sont nécessairement arrondies [11].. Ainsi un
maximum qui semble égal à 2 peut être en réalité \( \frac{31}{16}\) , ce qui change tout quant
au nombre de solutions de l’équation f (x) = 1,95.
• Interpolation : la calculatrice utilise un pas de tabulation ; elle ne peut donc rien
indiquer de ce qui se passe entre deux valeurs calculées [12]. Par exemple
l’observation sur [−5 ; 5] de la fonction \( x\mapsto x^{2} + \frac{sin(10\pi x)}{10}\) suggère un tableau
de variation faux.
• Extrapolation : une représentation nécessairement bornée ne dit rien de ce qui se
passe en dehors de la fenêtre de visualisation. Par exemple l’observation sur [−5 ; 5] de la fonction \( x\mapsto x^2 - \frac{x^{4}}{1000} \) suggère un tableau de variation faux.
C’est pourquoi l’utilisation des outils informatiques suppose des objectifs
didactiques clairs : faire des mathématiques, c’est essayer d’expliquer le monde, ce
n’est pas fournir des recettes de cuisine d’origine inconnue. Chaque fois qu’on peut
expliquer comment fonctionne le logiciel, il faut le faire. Par exemple les tableurs
disposent d’une fonction « solve » pour résoudre les équations : notre rôle est
d’expliquer le principe des algorithmes de résolution, à savoir le balayage de plus en
plus fin, éventuellement en le faisant pratiquer « à la main » sur un exemple, pour
combattre l’aspect « boîte noire » qui contrevient à nos objectifs de clarté.
Bien entendu, on ne dispose pas toujours des outils de démonstration qui seraient
nécessaires, et il faut parfois admettre que ce que suggère la courbe ou le tableau est
bien vrai. Il est alors capital en termes de formation que les élèves sachent distinguer
ce qui est démontré et ce qui est admis.
Notons à ce propos que trop de manuels entretiennent le flou sur le statut des
affirmations : s’agit-il de définition, de conjecture, ou de théorème [13] ? S’il s’agit
d’un théorème, est-il démontré ou admis ? S’il est admis, est-ce parce que sa
démonstration est évidente (danger : bien des choses qui semblent évidentes sont
fausses !), ou trop difficile, ou sans intérêt (selon quels critères) ? Les réponses
diffèrent et évoluent selon le niveau d’enseignement : qu’on pense par exemple à
l’équation f (x) = k déjà évoquée. Il y a là de vrais enjeux didactiques.
Le fait d’être obligé d’admettre certains résultats est ennuyeux quant à l’objectif de
développer le sens critique. Mais c’est aussi ce qui motive, pour les scientifiques,
l’introduction de ces outils théoriques qui en Analyse s’appellent précisément limites,
continuité, dérivation, …
D’autres outils que la dérivation
Pour étudier le sens de variation il existe aussi d’autres outils, qui ne demandent pas
d’admettre autant de choses que le calcul différentiel :
1) Les définitions
Pour les fonctions de référence, il me paraît essentiel d’établir leur sens de variation
par les définitions. C’est en effet une façon de faire vivre ces définitions, de pratiquer
les inégalités, de donner un nouvel éclairage (graphique et fonctionnel) à des règles
antérieures concernant les inégalités. Se contenter d’observer les courbes serait
contre-formateur pour les raisons signalées ci-dessus.
Au-delà des fonctions de référence, le calcul différentiel n’est-il pas un outil
disproportionné pour étudier le sens de variation de fonctions comme \( x\mapsto\sqrt{x+1} \) ou \( x\mapsto\frac{3}{x}\)
? La simple application de la définition permet de conclure.
Pour les fonctions sin, cos, tan, la simple observation du cercle trigonométrique
indique leur sens de variation sans qu’il soit besoin de dériver.
Dans le même ordre d’idées, pour trouver le maximum de la fonction \(x \mapsto1-x^{2}\) ou
le minimum de \(x\mapsto (x-3)^{2} + 2 \), il serait bien maladroit de dériver, alors que
l’extremum est en évidence dans l’écriture de la fonction.
2) Les changements d’écriture et les fonctions associées
Le programme de Première ES comporte un chapitre dit « fonctions associées »
souvent considéré comme difficile et peu utile.
Si on ne dispose pas de la dérivation, le deuxième argument tombe.
Quant au premier, je pense que si on y passe le temps nécessaire, qui est long, et
qu’on choisit des activités « concrètes », on dispose d’un outil performant pour
donner du sens aux fonctions.
On peut ainsi, à partir de la fonction « carré », étudier toutes les fonctions trinômes.
On a dénoncé à juste titre la « trinomite » [14]. Mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec
l’eau du bain ! Apprendre à écrire de plusieurs façons équivalentes une fonction
trinôme, de façon à choisir l’écriture la mieux adaptée au problème posé, me paraît
très formateur. De plus cela montre l’intérêt du calcul algébrique, et notamment des
identités remarquables. Les fonctions de coût du second degré, par exemple,
permettent des activités riches : pour étudier le signe du résultat d’exploitation on
peut utiliser l’écriture factorisée, pour maximiser le profit on peut utiliser l’écriture
canonique… Le second degré est aussi l’outil de l’ajustement par moindres carrés,
dont la problématique me paraît très formatrice (et dont l’étude est grandement
facilitée par le tableur).
De même, la forme canonique d’une fonction homographique ramène son étude à
celle de la fonction « inverse », et met en évidence toutes les propriétés utiles.
3) Les opérations sur les fonctions, notamment la composition
Il est immédiat de trouver le sens de variation de kf connaissant celui de f , et d’établir
que la somme de deux fonctions croissantes (respectivement décroissantes) est
croissante (respectivement décroissante). On peut ainsi montrer sans dériver que la
fonction \( x \mapsto x-\frac{1}{x}\) est croissante sur \(]0, +\infty[\).
Quant à la composition des fonctions, elle est réputée difficile. Mais pourquoi ?
Principalement parce que la notion de fonction n’est pas perçue pour ce qu’elle est :
la façon dont une grandeur dépend d’une autre. Si ce point de vue est acquis, il n’est
pas difficile de comprendre que si x détermine y et que y détermine z, alors x
détermine z. D’autant que le tableur permet de le visualiser, en attribuant une colonne
à chacune des trois grandeurs, ce qui montre l’enchaînement des formules.
Mieux : si le sens de variation de chaque fonction est connu, le sens de la variation
de la composée est connu. Si je sais que quand x augmente y diminue, et que quand
y diminue z diminue, j’en déduis que quand x augmente z diminue.
On démontre ainsi
par exemple que la fonction \(x \mapsto \sqrt{1-x}\) est décroissante : il suffit de poser y=1−x et \( z= \sqrt{y} \) et de faire le petit raisonnement ci-dessus, que le tableur rend limpide.
Cela suppose de varier les exemples, de composition mais aussi de décomposition.
Mais là encore, si on s’appuie sur des situations « concrètes » et qu’on prend le temps
nécessaire (on dispose du temps récupéré sur la dérivation) avec les outils adéquats,
on y arrive et cela a du sens.
Les moyens de travailler autrement
Ce qui précède suppose bien entendu de pouvoir utiliser largement le tableur. Pour
cela il faut pouvoir accéder régulièrement à une salle informatique fiable, ce qui n’est
malheureusement pas le cas dans tous les établissements.
Cela suppose aussi de pouvoir travailler en demi-classe. En ce qui concerne la
section STG, nous avons à plusieurs reprises interpellé la DESCO à ce sujet, avec
l’appui de l’inspection générale, de l’APMEP, des syndicats : nous n’avons pu
obtenir de dédoublement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le CSE, bien que
portant une appréciation positive sur le contenu du programme de Première, a voté
contre en juin 2004 (mais son avis n’étant que consultatif, le ministère est passé
outre…).
La poursuite des études
Une minorité d’élèves de sections non-scientifiques auront à pratiquer des
mathématiques après le baccalauréat. C’est le cas s’ils vont en faculté de sciences
économiques, en classe préparatoire tertiaire, en BTS ou IUT d’informatique, … Il
faut que ces bacheliers puissent suivre ces études supérieures. C’est pourquoi, si
évolution il doit y avoir, elle ne peut pas être brutale ni isolée.
Pour la section STG, le GEPS a voulu privilégier la qualité sur la quantité, partant du
principe qu’« une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine » (et tenant
compte du volume horaire limité). Pour ce qui est de l’Analyse, il a donc reporté en
post-bac les limites et l’intégration [15] Il semblait en effet abusif d’imposer ces
notions très difficiles à l’ensemble des élèves, qui n’en feront rien et qui ont besoin
de temps pour comprendre et pratiquer le reste du programme.
Mais il faudra que les études supérieures évoluent elles aussi. À court terme, pour
s’adapter au niveau des nouveaux bacheliers. À long terme, pour tenir compte des
nouvelles approches des fonctions que j’ai évoquées. Est-il vraiment nécessaire
d’imposer le calcul différentiel à tant d’étudiants qui n’en auront jamais l’usage ?
On parle aujourd’hui de socle commun : je dirais pour conclure qu’au lycée, les
fonctions font partie du socle commun, alors que le calcul différentiel n’en fait pas
partie.
Bibliographie
[1] KUNTZ G., De l’utilité d’une formation mathématique pour la vie économique
et sociale, in Repères-IREM no 18 et Bulletin de l’APMEP n° 452.
[2] Grandeur, mesure, Brochure APMEP n° 46, 1982.
[3] COMIN E., Variables et fonctions, du collège au lycée, in Petit x n° 67, 2005.
[4] GASQUET S. et CHUZEVILLE R., Fenêtres sur courbes, CRDP de Grenoble,
1994.
[5] Modélisation, dossier des Bulletins APMEP n°s 456 et 458.
[ 6] BONNEVAL L-M., Mathématiques et économie : je t’aime, moi non plus, in
Repères-IREM n° 52.
[7] DOUADY R., Dialectique outil-objet et jeux de cadres, in Cahiers de didactique
n° 3, 1984.
[8]Document d’accompagnement des programmes de mathématiques de STG,